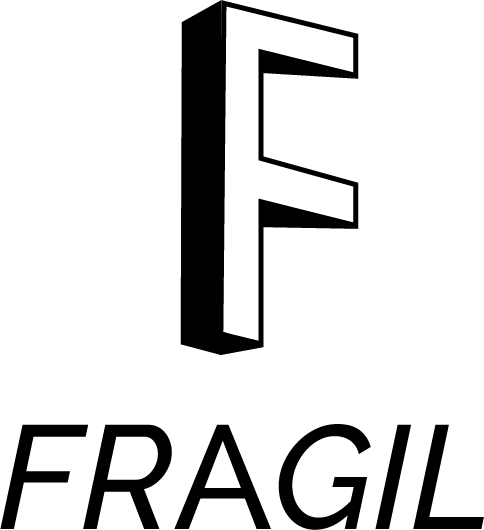Sorti en 1969, le film de Luchino Visconti, Les Damnés, rôde dans les zones malsaines de la montée du nazisme en Allemagne en 1933. Il exhibe l’ascension vénéneuse et illusoire de la famille Essenbeck, à la tête d’une entreprise d’aciérie, et sa progressive extinction, dans un monde qui bascule dans l’horreur. Il y a quelque chose de pourri dans ce groupe rongé de l’intérieur, et gangrené par un fantasme de pouvoir. Ivo van Hove a adapté d’autres films particulièrement intenses de réalisateurs italiens sur scène, notamment Rocco et ses frères de Visconti – un film de 1960 – , dont il monte aussi cette saison Ossessione – qui date de 1942 – , et Théorème de Pier Paolo Pasolini (1968), avec le Toneelgroep d’Amsterdam qu’il dirige depuis 2001. Pour jouer ces damnés, il a construit un discours intemporel, dans un jeu de miroir avec toutes formes de ténèbres, où de puissantes métaphores du théâtre commentent le glissement vers l’enfer.
Tragédie d’une famille rongée par le pouvoir
Le début du spectacle montre un théâtre en train de se faire avec, sur le côté, des loges d’acteurs. Les comédiens se changent et se regardent dans le miroir, avant de plonger dans des rôles impossibles. Ils entrent dans leurs costumes et leurs personnages, sous le regard d’une caméra qui ne quittera pas le plateau jusqu’à la fin. Cet accessoire de cinéma rend hommage au film de Visconti, et tourne autour des protagonistes. C’est aussi un personnage à part entière, témoin implacable, comme le chœur de la tragédie antique. Il y a en effet des rappels de la barbarie des Atrides dans l’histoire de la famille Essenbeck. Les images projetées en direct commentent et soutiennent l’action de manière parfois intime, en osant des gros plans sur des visages, des expressions ou des gestes.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2017/04/LD-©-Jan-Verswevyeld-11-photoshop.jpg » credit= »Jan Verswevyeld » alt= »Les damnes » align= »center » lightbox= »on » caption= »Un personnage toxique et étouffant, à l’âme d’une tueuse, dans un jeu plein de terrifiantes nuances. » captionposition= »left » revealfx= »off »]
La caméra s’invite à la soirée d’anniversaire du patriarche, le Baron Joachim Von Essenbeck, qui profite du rassemblement familial pour céder sa place à la tête de l’entreprise. Ses petites-nièces jouent à cache-cache tandis que Günther, incarné avec beaucoup d’intensité par Clément Hervieu-Léger, interprète un morceau de clarinette pour la fête de son grand-père : il s’agit de la transposition d’un lied de Richard Strauss, Morgen, comme la réminiscence fragile d’un temps qui semble révolu. L’immense Didier Sandre offre son regard intense, profond et triste, au visage du baron, tourné vers un passé qui s’éloigne. C’est comme si le temps se figeait dans l’image bouleversante, agrandie à l’arrière-plan, de celui qui prend encore le temps d’écouter. C’est son fils Konstantin, père de Günther, qui doit lui succéder. L’émotion esthétique est très vite balayée par l’émergence de désaccords internes autour de la nouvelle direction, dictés par le nazisme mais complètement assumés par certains membres de la famille.
Le Baron Joachim a un autre petit-fils, Martin, fils de Sophie, sa belle-fille. Martin offre en cadeau d’anniversaire l’interprétation grinçante d’une chanson immortalisée par Marlene Dietrich dans le film L’ange bleu de Josef Von Sternberg (1930), Ein Mann, ein richtiger Mann, dans un numéro de travesti. Sophie, en véritable démiurge, lui enfile les chaussures à talons, avec une délectation qui révèle le caractère trouble de la relation qui les unit. Dans un moment où tout semble basculer, ce passage dit de manière outrancière l’urgence de trouver un homme, un vrai, un guide aussi, avec l’expression maladroite due à un manque profond de repères.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2017/04/LD-©-Jan-Versweyveld-34-photoshop.jpg » credit= »Jan Versweyveld » alt= »photoshop- LD © Jan Versweyveld-33″ align= »center » lightbox= »on » caption= »Sophie Von Essenbeck et Friedrich Bruckmann sont infestés par une véritable maladie du pouvoir » captionposition= »left » revealfx= »off »]
[aesop_quote type= »pull » background= »#282828″ text= »#FFFFFF » align= »left » size= »1″ quote= »La tragédie des époux Macbeth n’est pas si loin » parallax= »off » direction= »left » revealfx= »off »]
Alors qu’Helmut Berger donnait à cette scène mythique du film de Luchino Visconti une présence sensuelle et inquiétante, Christophe Montenez accentue encore l’exubérance, avec ses colliers et ses bagues démesurés, dans un fascinant ballet avec la caméra. Il a le côté animal de celui qui est prêt à tout pour exister, avec quelque chose du monstre naissant tel que Racine dépeint Néron, sous le regard de sa mère Agrippine dans sa pièce Britannicus (1669). D’autant que Sophie Von Essenbeck manipule son fils, à la personnalité fragile, pour assouvir sa propre volonté de puissance. Elle est infestée, comme Friedrich Bruckmann dont elle partage désormais la vie, par une véritable maladie du pouvoir. La tragédie des époux Macbeth n’est pas si loin. Sur l’écran qui nous montrait le beau visage du patriarche ému par la musique, on voit celui qui vient de fêter son anniversaire, froidement assassiné par Friedrich. Guillaume Gallienne apporte à cette figure monstrueuse une redoutable impassibilité, que rien ne semble atteindre. La nuit précédente, c’était l’incendie du Reichstag – nuit du 27 au 28 février 1933 – , avec son faux coupable. Herbert Thallman, libéral anti-nazi marié à une Essenbeck, est accusé du meurtre du baron. Il n’y a pas si longtemps, c’étaient ses petites-filles qui jouaient à cache-cache ; il est désormais contraint à l’exil.
Miroir d’un monde en décomposition
Le titre italien donné par Visconti aux Damnés est La caduta degli dei, qui évoque la dernière journée de la Tétralogie de Richard Wagner, Le crépuscule des Dieux (1876). Ivo van Hove a monté l’ensemble de cette œuvre énorme entre 2006 et 2008 à l’Opéra des Flandres. Il y est question de dieux à l’agonie, mais animés par un pouvoir aussi vain, qui repose sur l’ivresse de l’or, et d’une puissance dérisoire. Ces dieux partagent avec la famille Essenbeck un même aveuglement. Friedrich Bruckmann tente de combler ses frustrations lors de la sordide nuit des longs couteaux – du 29 au 30 juin 1934 – , dans une totale confusion entre sa sphère privée et son engagement politique.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2017/04/photoshop-LD-©-Jan-Versweyveld-33.jpg » credit= »Jan Versweyveld » alt= »photoshop- LD © Jan Versweyveld-33″ align= »center » lightbox= »on » caption= »Friedrich Bruckmann tente de combler ses frustrations lors de la sordide nuit des longs couteaux » captionposition= »left » revealfx= »off »]
A lire aussi : Le crépuscule des dieux à l’Opéra Bastille
Devenu S.S, il participe au massacre des S.A, dans l’espoir de liquider son adversaire Konstantin, converti à cette dernière section. Cette nuit des longs couteaux est stylisée et le passage est d’une beauté suffocante. Le dirigeant légitime des aciéries Essenbeck danse avec le jeune Janeck. Les deux hommes sont nus, un déstabilisant jeu de miroirs les projette sur l’écran, en les amplifiant et en démultipliant les corps. C’est une esthétique complètement irréelle de cauchemar, aux couleurs de feu, d’un orange obsédant, qui devient ensuite une mare de sang. Denis Podalydès (Konstantin) et Sébastien Baulain (Janeck) offrent une brûlante scène d’anthologie, d’une splendeur monstrueuse. Portés par la fièvre, les deux acteurs semblent complètement possédés, dans l’ivresse d’une bacchanale qui les place en équilibre au-dessus d’un gouffre. C’est une danse de mort, d’une puissance orgiaque, dont Bruckmann rompt brutalement la sauvage sensualité en abattant Konstantin comme il avait tué le grand-père, sans aucune trace d’émotion. On entend, au piano, la musique du songe d’Elsa dans Lohengrin de Wagner, où il est question de l’espoir d’un rédempteur. Mais cette musique assourdie paraît un bien lointain souvenir.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2017/04/LD-©-Jan-Verswevyeld-10-photoshop.jpg » credit= »Jan Versweyveld » alt= »photoshop- LD © Jan Versweyveld-33″ align= »center » lightbox= »on » caption= »C’est une esthétique complètement irréelle de cauchemar, aux couleurs de feu, d’un orange obsédant (…) » captionposition= »left » revealfx= »off »]
[aesop_quote type= »pull » background= »#282828″ text= »#FFFFFF » align= »left » size= »1″ quote= » Le propos est universel, et nous concerne » parallax= »off » direction= »left » revealfx= »off »]
A chaque crime, les lumières de la salle s’allument, et l’on entend le bruit sinistre des sirènes d’un train. Le spectateur est impliqué dans l’action, à la fois voyeur et témoin impuissant. Ces lumières nous renvoient aussi à notre monde d’aujourd’hui, ici et maintenant. Le propos est universel, et nous concerne. Sur le côté de la scène opposé à celui des loges d’acteurs, en bordure des coulisses mais à la vue du public, on a placé des cercueils où chaque mort est déposé. Le rituel macabre se développe avec une urne que l’on amène à l’avant du plateau, pour y jeter les cendres. Le retour d’Herbert Thallman est un moment bouleversant. Il revient anéanti après avoir appris la mort d’Elisabeth, sa femme, et de ses deux petites-filles, dans les camps. C’est le seul personnage qui soit parvenu à rester pur. Loïc Corbery atteint, par un jeu authentique et sincère, l’expression d’une douleur indicible qui tire les larmes. Günther, de son côté, réagit au crime de son père par une montée de haine, attisée par le personnage manipulateur de Wolf Von Aschenbach, qui se sert du discours nazi pour corrompre et séduire les esprits déstabilisés. Eric Génovèse s’empare de cette figure inquiétante avec la beauté du diable et une froideur totale. Ses mots glissent comme les ondulations d’un serpent sur ceux qui ne voient plus le sens des choses. Il est effrayant de perfection, et parvient à pervertir une sensibilité pourtant artiste, pour qu’elle se dirige vers la vengeance et l’idéologie la plus extrême. Cette métamorphose nous montre comment tout être peut basculer. C’est encore un pas franchi dans l’horreur.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2017/04/LD-©-Jan-Versweyveld-25.jpg » credit= »Jan Versweyveld » alt= »photoshop- LD © Jan Versweyveld-33″ align= »center » lightbox= »on » caption= »Lors d’une scène traumatisante, Martin profite d’une partie de cache-cache avec Lisa, une petite fille juive, pour suggérer avec perversité le viol à venir » captionposition= »left » revealfx= »off »]
Martin dérape dans une attitude radicale. Il s’affirme progressivement comme un monstre accompli, dans un monde qu’il ne parvient plus à maîtriser. Lors d’une scène traumatisante, il profite d’une partie de cache-cache avec Lisa, une petite fille juive, pour suggérer avec perversité le viol à venir. On n’aura ensuite plus de nouvelles de l’enfant. Sophie consacre toute son énergie à hisser son fils au sommet des entreprises Essenbeck, pour satisfaire sa soif de pouvoir personnelle. Elsa Lepoivre, qui a été une Phèdre solaire dans la pièce de Racine à la Comédie Française, construit un personnage toxique et étouffant, à l’âme d’une tueuse, dans un jeu plein de terrifiantes nuances.
A propos de Phèdre à la Comédie-Française : Des mots en offrande à la mer…
Aux portes de l’atroce dénouement, son fils lui arrache sa robe, dans un acte de profanation dont elle sort abîmée et salie, presque désincarnée. Ce n’est qu’un prélude à l’horreur. Martin, devenu directeur des aciéries familiales, se dénude face au public, et déverse sur son corps toutes les cendres mêlées contenues dans l’urne. La mécanique destructrice est en marche. Il s’empare d’une arme et tire de manière convulsive en direction de la salle. Cette fin laisse sans mots et sans voix, elle résonne tellement avec des événements inexplicables, si proches de nous. La Comédie-Française a offert un spectacle total, qui marquera l’histoire du théâtre. Elle programme également cette saison, jusqu’au 15 juin 2017, Salle Richelieu, une adaptation de La règle du jeu de Jean Renoir (sorti en 1939), dans une mise en scène de Christiane Jatahy. Jouer des films s’inscrit dans une démarche passionnante. C’est une autre manière, pour la Comédie-Française, de revisiter des classiques et d’enrichir le répertoire.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2017/04/LD-©-Jan-Versweyveld-31.jpg » credit= »Jan Versweyveld » alt= »Les damnés » align= »center » lightbox= »on » captionposition= »left » revealfx= »off »]