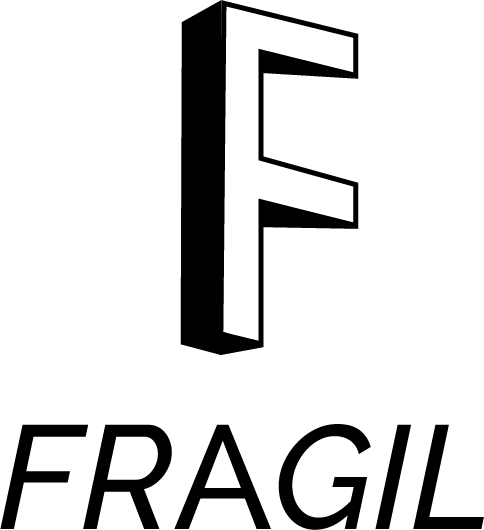« Faire pousser les ronces », c’est un texte écrit à l’encre rouge en lettres capitales, sorte de palimpseste urbain, couvrant un autre texte sous-jacent couché sur un drap style étendard de manifestant, à l’écriture volontairement décalée, et dont la lisibilité requiert un effort. Originale visuellement, cette création interpelle. L’injonction vient d’un recueil de poèmes intitulé Extrait des Nasses, publié par Justin Delareux en 2016. Le galeriste Olivier Meyer explique dans le dossier de presse que la ronce « ne se cultive pas, mais se développe de manière autonome en zone délaissée et colonise des terrains où d’autres graines peuvent facilement germer. »
« Sur la petite commune. Césures. Un bonheur difficile mais immédiat. Comme un ressac. Il faudrait se frayer un chemin. Une philosophie. Nous faisons pousser les ronces. »
Dans l’espace assez restreint de cette modeste galerie nantaise qui n’a pas même d’enseigne, d’autres oeuvres poético-politiques ne demandent qu’à êtres vues, lues, entendues : des cartes topographiques repeintes en noir à l’encre industrielle, des photos où la question du temps qui passe est évoquée avec subtilité (une paire de Nike abandonnées en forêt, dans laquelle pousse de la mousse), des dessins, des collages où il est question d’ « oeuvrier », de souvenirs du prolétariat, d’émeutes, avec une écriture à la typographie non conventionnelle, insurgée…
Agrandir

L’esthétique est plutôt sombre, froide, le ton grave, le message clairement contestataire. Pour contrer la « tyrannie du présent », l’artiste est dans une action poétique « hors-livre ».
Si écrire, peindre, photographier, dessiner, coller, composer servent le dessein de distiller de la poésie dans le quotidien contemporain, c’est réussi. Et merci, car les ronçards qui piquent notre curiosité se font trop rares aujourd’hui.
Agrandir

Justin Delareux est également rédacteur en chef de la revue PLI (Projectile Littéral). Son dernier recueil Parloar est paru en 2018 aux éditions Pariah.
Interview en 3 questions de l’intéressé
Fragil : Vit-on de la poésie en France en 2018 ? (et si oui, comment/combien?)
Justin Delareux : Non, mieux vaux vendre du haschisch. On dit aussi que Rimbaud opérait, un temps, dans le trafic d’armes. Pouvait-on vivre de la poésie en 1886 ? Voulait-on vivre de la poésie en 1886 ? Et en 2018 ? En fait, je ne suis pas certain de pouvoir répondre à la question. Je me méfie un peu des milieux, y compris celui de la poésie. Donc je ne sais pas si l’on vit de la poésie aujourd’hui en France en 2018. La poésie telle que je la perçois vit de débrouille et de révoltes, puis il y a les affairistes de l’autre côté, comme au temps de Ponge, pas grand chose n’a changé, finalement. On ne vit pas de la poésie, on essaie de vivre, malgré tout, on a nos petits arrangements avec la mort, comme dit un ami.
Fragil : Les émeutes des quartiers nantais de l’été dernier vous ont-elles inspiré ? (et si oui, quoi?)
Justin Delareux : Non certainement pas, ou alors je ne sais plus très bien ce que veut dire « inspirer » dans ce cas.
En revanche, l’assassinat (c’en est un non?) d’un jeune homme sans arme et non offensif (qui avait l’âge de ma petite sœur) de deux balles dans la nuque à bout portant (tout de même) par un dit « représentant des forces de l’ordre » (tout de même), oui, ce fait misérable (de plus et de trop) m’a écrasé. Comme je suis écrasé à chaque fois que j’apprends une « nouvelle » exaction policière, en fonction ou hors fonction, mais j’ai l’impression que ces gens là ne quittent jamais vraiment leur fonction. Dire que ces émeutes m’auraient inspirées serait une insulte. La pratique artistique (et les discours qui l’accompagnent) n’ont rien à récupérer dans un fait pareil. Je suis tout autant révolté quand j’entends les représentants politique qui « dénoncent les violences » sans même dénoncer les meurtres qui engendrent ces violences… étrange chose que l’injustice se plaigne de l’incivilité !
Fragil : Qu’entendez-vous par « tyrannie du présent » ?
Justin Delareux : Je fais référence à un texte de l’historien Jérôme Baschet, ou plutôt une suite de textes rassemblés dans un ouvrage intitulé : Défaire la tyrannie du présent. Cette tyrannie du présent c’est cette obligation à être de l’actuel toujours plus actuel, d’une sorte de présent tellement présent qu’il en anéantit toute possibilité de présence, d’être au monde, il anéantit la mémoire et la projection par la fabrique d’une représentation de la projection… Les supports numériques produisent une éternelle impression de retard, de manque, la fabrication d’une disponibilité constante à ce qui nous entoure, alors même que c’est tout l’inverse qui se réalise. L’art comme la révolte permettent de s’extraire du présent et d’y être tout entier, dans un même mouvement, fait de recul et d’attaque, d’observation et de report. Ces moments de création […] sont des moments de puissance joyeuse, sans cette sensibilité là, cette attention, aucune révolte émancipatrice ne sera possible. Les dispositifs de contrôle et de représentation nous privent de cette joie, ils produisent des empêchements intermédiaires, fabriquent des manques immédiats. Créer pourrait être l’une des méthodes qui permettrait de se défaire de ce présent là.