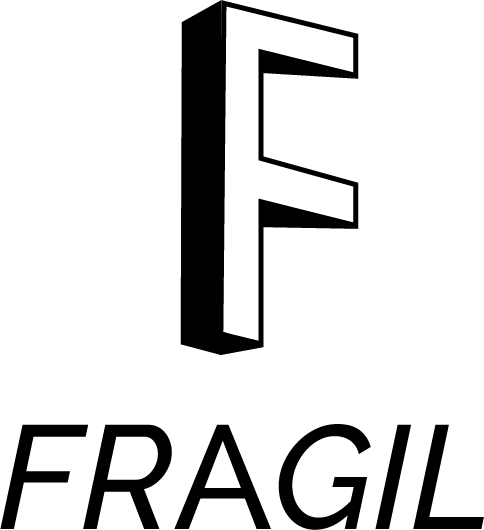Depuis 2018, Fragil a été sollicité chaque année par les deux éducateur·ices de la MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire), installée au sein du lycée Monge La Chauvinière de Nantes. Avec deux sessions de six séances par an, c’est en tout une centaine d’heures que les différent·es salarié·es de l’association ont animé avec des adolescent·es âgé·es de 15 à 17 ans. Face à une restructuration des missions de la MLDS à la rentrée 2023 l’activité de Fragil ne sera pas reconduite pour la saison prochaine, l’occasion de dresser un bilan de ce projet.
Aller à la rencontre d’un public hétérogène
Plus de la moitié des interventions menées par Fragil sont adressées à un public scolarisé, en particulier à des collégien·nes. Au commencement du projet en 2018, c’était alors la première fois, de mémoire de salarié·es actuel·les, que l’association intervenait au près de jeunes adolescent·es déscolarisé·es inscrit·es dans un processus de réinsertion. Souvent déstabilisante, parfois surprenante, la diversité des profils a poussé les salarié·es de l’association à sans cesse remettre en question ses ateliers et à adapter ses formats afin de les rendre plus attractifs.

« J’ai été surpris par l’hétérogénéité des niveaux » confie François-Xavier Josset, animateur chez Fragil, en revenant sur la première série d’ateliers menée à l’automne 2018. Si les jeunes ont tous et toutes entre 15 et 17 ans, elles et ils sont issu·es de parcours parfois diamétralement opposés. Si pour certain·es leur présence résultait d’une phobie scolaire ou de mauvaises expériences sociales dans leurs établissements d’origine, d’autres étaient là suite à une exclusion, un manque d’intérêt ou bien parce qu’ils ou elles venaient tout juste d’arriver en France.
« C’est plus entrainant qu’un cours banal«
Cette diversité des niveaux constitue « la principale difficulté » pour François-Xavier, qui reconnait néanmoins avoir été agréablement surpris par « l’intérêt que les jeunes portent pour les médias« . Grâce à l’utilisation de méthodes d’éducation populaire telles que le débat, la discussion, la prise en main des outils ou encore la réflexion critique des usages, l’ensemble des participantes et participants a pu s’emparer à un moment ou à un autre des questions liées aux médias. S’écarter du modèle du cours magistral, ne pas donner de devoirs aux élèves en sortant du cours sont autant d’éléments auxquels les animateur·ices ont prêté attention tout au long du projet. Une organisation qui plait aux élèves comme le souligne un ado rencontré lors de la dernière session « comme c’est sous forme de débat c’est plus entrainant qu’un cours banal« .
Des ateliers en constante évolution
En cinq ans d’animation, les ateliers d’éducation aux médias proposés par Fragil ont évolué pour se rapprocher au mieux des attentes des jeunes. D’une durée initiale de deux heures, par groupe de quinze, les ateliers sont désormais organisés en 1h30 par demi groupe, soit entre cinq et huit personnes. Le contenu des ateliers a également évolué au fil des années. Lors de la première saison d’intervention, entre octobre 2018 et mai 2019, les animateurs de Fragil ont proposé une série d’ateliers centrée sur la critique et la pratique du journalisme. En une dizaine de séances, les jeunes ont pu évoquer ensemble le rôle des médias, la construction des fake news ou encore partir en reportage au sein du lycée.
« J’ai pu discuter de certaines choses dont j’avais envie de parler et qui ne sont pas souvent abordées […]«
Face à un public plutôt volatile, les ateliers se sont dirigés vers des séances aux thématiques uniques, distinctes les unes des autres afin que chacun·e puisse accrocher au thème peu importe son investissement sur le long terme. Bien « qu »habitué à l’absentéisme« , Merwann Abboud, à l’époque animateur d’ateliers chez Fragil, souligne l’importance de ces thématiques pour ce jeune public. Il dresse un bilan positif suite à ces années de collaboration avec la MLDS, « ce qui a fonctionné c’est tout simplement l’éducation aux médias, les jeunes sont intéressés par les réseaux sociaux, la création de l’information… ». Son collègue François-Xavier rejoint ce constat et souligne « l’adaptabilité constante » nécessaire pour mener à bien une série d’interventions, notamment via la création d’ateliers sur des sujets plus actuels ( la téléréalité, le cyberharcèlement, le monde de l’influence…) mais aussi l’appel plus régulier à la discussion et aux éventuelles digressions pendant les séances.
Pour Ketsia, adolescente ayant participé à la dernière session d’ateliers, « les sujets abordés étaient très intéressants, j’ai pu discuter de certaines choses dont j’avais envie de parler et qui ne sont pas souvent abordées dans la vie de tous les jours comme la discrimination dans les médias ou le cyberharcèlement« . Parmi les retours des élèves du même groupe, beaucoup soulignent « la découverte de nouvelle choses » comme point positif ainsi que « l’utilité » des informations échangées.
« En adaptant le contenu à chaque séance on est déjà dans l’amélioration. »
Concernant d’éventuelles pistes d’amélioration suite à ces cinq ans d’ateliers, Merwann évoque l’organisation « d’une première séance commune pour que tous·tes les élèves choisissent les thématiques à traiter par la suite« , ce qui amène plus d’engagement selon lui. François-Xavier quant à lui n’évoque pas de piste de changement car « on était déjà en constant changement à chaque cours, en adaptant le contenu à chaque séance on est déjà dans l’amélioration« . Les derniers participant·es des ateliers animés en 2023 regrettent parfois « un temps d’atelier trop long, « un manque de sérieux des élèves » ou encore » un manque de communication dans le groupe« .