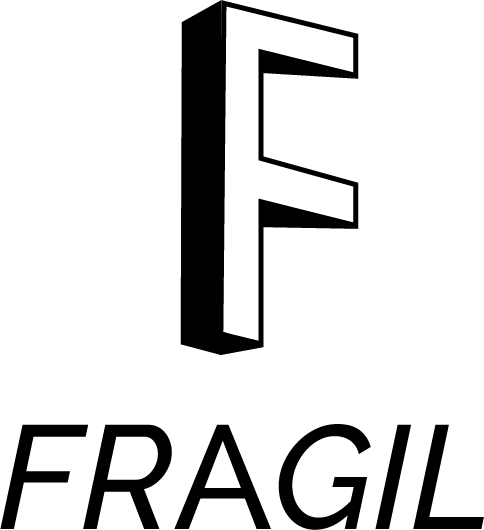On associe généralement le nom de Kurt Weill à celui de Bertolt Brecht, avec des ouvrages en langue allemande, ancrés dans les années berlinoises du compositeur, entre 1927 et 1930. Ces deux artistes ont notamment collaboré sur L’opéra de quat’sous (1928), inspiré du Beggar’s Opera de John Gay (1728) et Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny (1930), dont Angers Nantes Opéra a présenté une vision marquante de Patrice Caurier et Moshe Leiser en 2009. Ces œuvres particulièrement engagées montrent les excès du capitalisme et les débordements d’une société corrompue. Kurt Weill fuit l’Allemagne nazie en 1933, et émigre aux États-Unis en 1935. Les œuvres qu’il y compose portent aussi un regard critique sur la société. Ainsi, son ultime tragédie musicale, Lost in the stars (1949), dénonce l’apartheid en Afrique du Sud ; le festival de Saint-Céré en a réalisé en 2012 un spectacle d’une grande force. Kurt Weill avait découvert Street Scene (Scène de rue), la pièce d’Elmer Rice, à Berlin en 1930. Il l’adapta en opéra en 1947, sur un livret de l’auteur de la pièce, avec l’ambition d’en faire le premier opéra américain. Cet ouvrage atteint en effet une fusion parfaite entre théâtre et musique, avec des chœurs impressionnants et des élans de lyrisme qui évoquent Puccini. On reconnaît des traces de cette œuvre fondatrice chez les compositeurs qui suivront, et notamment Carlisle Floyd avec deux opéras qui posent aussi la question de la place de l’individu face au groupe, Susannah (créé en 1955, Susannah a été représenté à l’Opéra de Nantes en mars 1997) et Des souris et des hommes (créé en 1970, Des souris et des hommes a été représenté à l’Opéra de Nantes en novembre 1999) d’après le roman de John Steinbeck.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2020/04/140-Street-Scene-Générale-©2020-Alain-Hanel-OMC-20.jpg » credit= »Alain Hanel » align= »center » lightbox= »on » caption= »L’action de Street Scene a pour cadre un immeuble rongé par la misère sociale » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Un immeuble rongé par la misère sociale, entre rêves impossibles et désillusions…
L’action de Street Scene a pour cadre un immeuble rongé par la misère sociale, entre rêves impossibles et désillusions, avant que n’éclate un drame. Dans l’imposant décor de Dick Bird, la mise en scène de John Fulljames, réalisée à Monte Carlo par Lucy Brodley, sculpte des présences marquantes aux nombreuses figures qui traversent l’opéra, dans la moiteur de journées qui se répètent.
Rue des désillusions
Le décor représente la façade d’un immeuble urbain, dans l’East Side, à New York. Les escaliers métalliques reliant chaque étage donnent à voir sur toute la hauteur du plateau le quotidien de familles qui se croisent, dans un mouvement cinématographique qui descend jusqu’à la rue. Ainsi, des tranches de vie se dessinent, ponctuant l’action de détails réalistes : l’épouse de Daniel Buchanan est sur le point d’accoucher, un voisin communiste fait l’éloge d’un monde meilleur basé sur une meilleure répartition des richesses, Rose Maurrant doit se rendre aux funérailles d’un agent immobilier , tandis que la famille Hildebrand est menacée d’expulsion de son logement. Les murs de l’immeuble s’écartent à deux moments du spectacle, pour révéler, à l’arrière plan, des tours aux lumières dorées, reflet d’un rêve américain qui semble bien illusoire.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2020/04/140-Street-Scene-©-2020-Alain-Hanel-OMC-17.jpg » credit= »Alain Hanel » align= »center » lightbox= »on » caption= »Les murs de l’immeuble s’écartent à deux moments du spectacle, pour révéler, à l’arrière plan, des tours aux lumières dorées » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
« Ses rêves se sont noyés dans l’eau de vaisselle »
Anna Maurrant, une des figures centrales de l’opéra, est mariée à Frank, un homme violent. La musique exacerbe les battements de son cœur, dans des arias d’une poignante vérité où elle exprime désormais un manque et d’amers regrets conjugaux. Elle a voulu être « une bonne mère, une bonne épouse, mais ça n’a ne l’a pas touché »,et « ses rêves se sont noyés dans l’eau de vaisselle ». Patricia Racette apporte beaucoup d’authenticité et une profonde justesse à ce personnage de femme blessée mais qui reste vivante. Son tempérament et l’éclat de sa voix portent l’empreinte des immenses Tosca (notamment dans la mise en scène de Luc Bondy au Metropolitan Opéra de New York), Madame Butterfly et Salomé qu’elle a incarnées ! Cette saison, elle interprète Elle dans « La voix humaine », dont elle signe la mise en scène à l’Opéra de Dallas. On imagine avec beaucoup d’émotion toute l’intensité que cette magnifique artiste donne à ce déchirant monologue de Jean Cocteau, mis en musique par Francis Poulenc.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2020/04/140-Street-Scene-©-2020-Alain-Hanel-OMC-12.jpg » credit= »Alain Hanel » align= »center » lightbox= »on » caption= »Anna Maurrant, une des figures centrales de l’opéra, est mariée à Frank, un homme violent. » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
«A quoi sert la lune si elle n’éclaire pas l’homme qu’on aime? »
Rose, leur fille, porte en elle l’idéal d’un ailleurs. Son patron lubrique lui propose de chanter à Broadway, mais elle lui résiste par ces mots d’une lumineuse poésie , «A quoi sert la lune si elle n’éclaire pas l’homme qu’on aime? », que la soprano Mary Bevan enveloppe de brillants aigus. Sam Kaplan est épris de Rose. Ce jeune homme différent et plein de délicatesse dévore les livres et se prépare à une carrière d’avocat. Il dévoile, dans une berceuse très émouvante, sa douleur et sa solitude parmi des brutes, véritable « meute de loups ».
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2020/04/140-Street-Scene-©-2020-Alain-Hanel-OMC-16.jpg » credit= »Alain Hanel » align= »center » lightbox= »on » caption= »Il dévoile, dans une berceuse très émouvante, sa douleur et sa solitude parmi des brutes » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Le même rêve de sortir de ce monde violent…
Le ténor Joël Prieto construit ce personnage attachant sur toute une palette de couleurs contrastées et d’ineffables nuances. Sam se fait assommer en prenant la défense de celle qu’il aime et qui a été harcelée lourdement par un fêtard, au cours d’ une scène de danse enfiévrée et de lutte qui annonce West Side Story de Léonard Bernstein (1957), adapté au cinéma en 1961. Sam et Rose partagent le même rêve de sortir de ce monde violent, mais l’amour n’est pas réciproque.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2020/04/140-Street-Scene-©-2020-Alain-Hanel-OMC-14.jpg » credit= »Alain Hanel » align= »center » lightbox= »on » caption= »Une danse enfiévrée » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Un drame de la jalousie
Dés le début de l’opéra, la chaleur est suffocante. Les habitants de l’immeuble se tiennent à l’extérieur, assis sur des marches ou s’attardant dans la rue. Dans ce monde clos, le regard des autres est omniprésent et les commérages se déchaînent rapidement : les ragots se fixent sur les visites régulières qu’Anna Maurrant reçoit de la part de Steve Sankey, le livreur de lait. Témoins impuissants d’un drame en marche, les résidents relèvent et commentent chaque détail d’une intrigue qui vient rompre leur ennui. De son côté, Willie, le petit garçon des Maurrant, se bagarre avec un autre enfant, qui a traité sa mère de pute.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2020/04/140-Street-Scene-Pré-générale-©-2020-Alain-Hanel-OMC-5.jpg » credit= »Alain Hanel » align= »center » lightbox= »on » caption= »De son côté, Willie, le petit garçon des Maurrant, se bagarre avec un autre enfant » captionposition= »left » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
« L’amour et la mort sont partis ensemble »
Frank Maurrant est un homme possessif, qui aime que chacun reste à sa place chez lui. Tout retard inexplicable de l’un de ses enfants le rend furieux, et sa méfiance atteint un paroxysme lorsque sa femme lui demande quand il rentrera, alors qu’il part pour un déplacement. Le baryton Paulo Szot restitue toute la violence de ce mari jaloux, que la moindre faille dans le quotidien suffit à dérégler. Cet artiste est un fascinant acteur, complètement investi dans la folie du personnage, et sa voix aux couleurs sombres atteint d’inquiétantes sonorités pour mieux se hisser à des explosions de fureur qui font frémir. Sam a vu le laitier monter dans l’appartement pour rejoindre Anna, avant d’assister au retour imprévu de Frank. Il essaie d’avertir à l’étage, durant un moment très dramatique, mais le piège se referme : le mari tue l’amant et blesse mortellement sa femme, que l’on emmène à l’hôpital où elle succombe. Sam est complètement anéanti et son monde s’écroule : il chante dans un débordement de lyrisme que « L’amour et la mort sont partis ensemble ».
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2020/04/140-Street-Scene-Générale-©2020-Alain-Hanel-OMC-81.jpg » credit= »Alain Hanel » align= »center » lightbox= »on » caption= »le mari tue l’amant et blesse mortellement sa femme, que l’on emmène à l’hôpital où elle succombe » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Tout reprend comme si rien ne s’était passé
C’est en rentrant des funérailles de l’agent immobilier que Rose découvre sa mère sur une civière. Lorsqu’elle y partait, un huissier de justice procédait à l’expulsion de la famille Hildebrand. L’action se déroule sur deux jours et les événements s’enchaînent et se précipitent avec de perturbantes résonances entre eux. Willie, son petit frère, fait désormais partie de ces enfants d’opéras qui perdent leur mère par la folie des adultes. Son histoire rejoint celle du petit garçon de Cio-Cio-San dans Madame Butterfly de Puccini (1904) ou de celui de Wozzeck d’Alban Berg (1925). Sam supplie Rose de partir avec lui, mais elle décide de n’appartenir désormais à personne, et de se consacrer à Willie, à qui sa mère avait dit juste avant de mourir qu’il serait un jour sa plus grande fierté. Dans une fragile image d’espoir, la jeune fille dit à son soupirant : « N’oublie pas que le lilas fleurit dans la rosée chaque matin ». De nouveaux locataires arrivent pour occuper l’appartement des Hildebrand, et tout reprend comme si rien ne s’était passé. Il fait toujours une chaleur suffocante et l’on chante les mêmes choses qu’au début de l’opéra, dans un mouvement qui résonne comme un avertissement, rappelant Peter Grimes de Britten (1945), où il y a un semblable recommencement malgré le drame. A la fin, des enfants jouent à la guerre, l’un d’eux fait le mort et les autres le montrent du doigt : l’ image d’un monde où rien ne change.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2020/04/140-Street-Scene-Générale-©2020-Alain-Hanel-OMC-82.jpg » credit= »Alain Hanel » align= »center » lightbox= »on » caption= »Il fait toujours une chaleur suffocante et l’on chante les mêmes choses qu’au début de l’opéra » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Le spectacle vivant et partagé est quelque chose d’irremplaçable.
A l’image de la population de l’immeuble, la partition est un melting pot de diverses influences, comme le jazz ( avec des réminiscences de Porgy and Bess de George Gershwin) ou le blues, aux côtés de formes traditionnelles de l’opéra tels des chœurs (superbes sous la direction de Stefano Visconti), des ensembles (un savoureux sextuor des glaces) et de bouleversantes arias. La mise en scène de John Fulljames reflète toute cette diversité, par une fascinante effervescence sur le plateau, dans l’urgence de ces deux journées particulières. La direction musicale de Lee Reynolds prolonge avec une belle énergie ce qui se joue sur scène, en mettant en relief toute la puissance de la musique, et d’ineffables nuances. On peut retrouver la magie de ce spectacle grâce au DVD filmé au Teatro Real de Madrid, paru en 2019 chez BelAir Classiques. Street Scene a été une belle découverte, avant la fermeture de tous les théâtres et des opéras suite à la pandémie qui traverse le monde. Sur la page d’accueil du site de l’Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda, son directeur, rappelle combien l’art est essentiel en cette période de confinement. Le spectacle vivant et partagé est quelque chose d’irremplaçable.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2020/04/DSC01402.jpg » credit= »Alexandre Calleau » align= »center » lightbox= »on » caption= »l’opéra de Monte-Carlo et l’Hôtel de Paris » captionposition= »left » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]