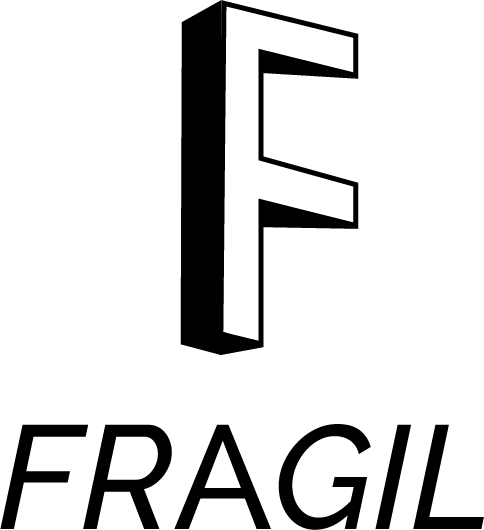L’âpreté du poème de Lydie Dattas, portée par la puissante fragilité de Vanille Fiaux, sous un éclairage cru, sans l’obscure complaisance du théâtre, a la force d’un cri. Le texte en effet est une réponse au rejet de Jean Genet que le compagnon de la poétesse, Alexandre Bouglione, avait invité chez eux. Objet de l’admiration de la jeune femme, le dramaturge, après cette soirée passée ensemble, lui avait pourtant opposé une fin de non recevoir radicale : « Je ne veux plus la voir, elle me contredit tout le temps. D’ailleurs Lydie est une femme et je déteste les femmes ». Cet insupportable camouflet, dans sa violence et son injustice misogyne, avait poussé Lydie Dattas à produire une réponse, visant à infléchir, avec son art, la position de Genet. Elle écrit « Cette parole qui me rejetait dans la nuit de mon sexe me désespéra. Trouvant mon salut dans l’orgueil, je décidai d’écrire un poème si beau qu’il l’obligerait à revenir vers moi. » Et Genet est revenu.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2018/03/La-Nuit-©-Simon-Le-Moullec.jpg » credit= »Simon Le Moullec » align= »center » lightbox= »on » captionposition= »left » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
C’est cette intrinsèque honte, irréconciliable, irrémédiable, que la poétesse vomit dans une logorrhée magistrale et rageuse…
Cette plume qu’elle lui oppose dans son ouvrage a pour but de « le blesser aussi radicalement qu’il l’avait fait, lui rendant mort pour mort. » Mais ce n’est pas Genet qu’elle attaque, c’est elle-même, c’est sa devenue indigne féminité, c’est la faute impardonnable à laquelle cette dernière, par essence donc, la condamne : « Quand je posai ma plume, face à sa haine des femmes luisait le bloc de nuit de mon poème, lequel en lui donnant raison lui donnait tort. » C’est cette intrinsèque honte, irréconciliable, irrémédiable, que la poétesse vomit dans une logorrhée magistrale et rageuse, dans une contrition absolue, essentielle, annihilante. C’est en se supprimant tout droit d’être, toute velléité à être autre chose que l’indignité femelle que Lydie Dattas touche au sublime : « N’ayant pas droit à la lumière je me noircirai davantage, je détournerai sur moi les ténèbres, afin, mon âme ayant bu toute l’ombre, que la beauté en soit lavée (…). Je m’efforcerai de rendre cette malédiction si profonde et si sombre qu’elle en soit belle (…) je l’utiliserai pour faire briller les ténèbres (…) Ne pouvant être au cœur de la beauté, je serai la Nuit. »
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2018/03/Nuit-Sprituelle-2-©-Fitorio-Théâtre.jpg » credit= »Fitorio Théâtre » align= »center » lightbox= »on » captionposition= »left » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Il fallait le potentiel tragique et la présence de Vanille Fiaux pour porter ce texte…
Il fallait le potentiel tragique et la présence de Vanille Fiaux pour porter ce texte, cette litanie païenne, ce râle profond et envoutant de désespoir et de revanche. D’ironie et de dérision aussi. Dans une robe en dentelle noire, de deuil ou de gala, sa silhouette gracile façonne une voix puissante, inattendue, intemporelle et sensuelle.
Sa complicité avec les membres du duo Seilman Bellinsky est flagrante et le dialogue entre la musique et la voix s’opère avec harmonie, sans que l’une ne prenne jamais le pas sur l’autre. La partie chantée survient d’ailleurs comme une évidence et répond à notre attente inconsciente. La musique semble porter encore la voix jusque dans les silences, comme pour mieux nous en imprégner, en augmenter la réception du sens.
L’esthétique et la sobriété de la mise en scène dans cet exercice de lecture rappellent à la fois la performance de musique classique et la tragédie grecque avec le chœur et son coryphée. Cette première idée gigogne est de mettre en scène le théâtre au cœur de cette mise en scène qu’est déjà l’espace muséal. Le sacré du musée, du silence quasi religieux et compassé qui y est souvent de mise, est ici heureusement contrarié. Dans cette salle d’exposition où des portraits de jeunes femmes sont également spectatrices, les Arts semblent converger pour créer une œuvre œcuménique. Conviant peinture, écriture, théâtre, architecture et musique, mélangeant classicisme et modernité, ils se répondent dans une bouleversante chorégraphie.
La nuit spirituelle offre une seconde représentation le 25 mars au Musée d’Arts de Nantes