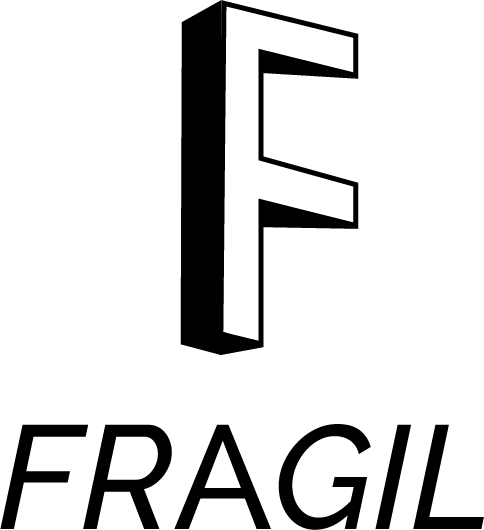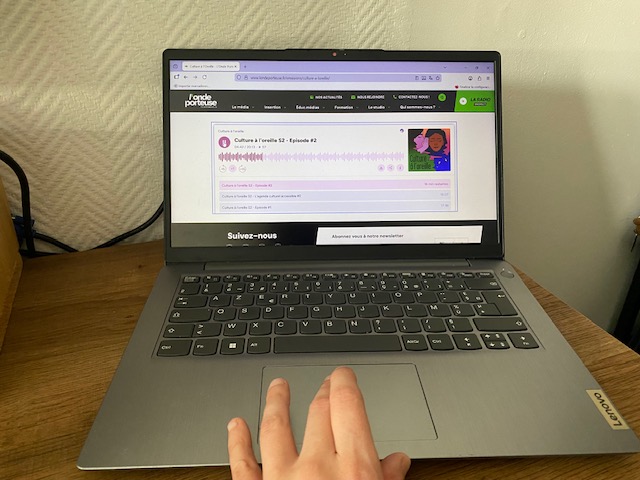« Les podcasts en temps normal c’est quelque chose d’assez individuel […] là le fait de pouvoir le partager en collectif et d’avoir l’occasion d’en parler après, de partager des ressentis, je trouve ça assez chouette » confie Emma, présente lors de la diffusion des témoignages audios de l’association NOMA qui organise des sessions d’écoute collective. Le 8 novembre dernier, les voix enregistrées de 7 femmes ont résonné au café des Impertinantes pour pouvoir converser autour de la multiculturalité.
Partager la pluralité des cultures
NOMA, acronyme de Nous Œuvrons pour un Multiculturalisme Audacieux, est une association créée par trois femmes : Janice, Nathalie et Evelyne. À travers celle-ci, elles veulent représenter le territoire nantais « où il y a de la mixité avec beaucoup de personnes qui sont venues vivre en France métropolitaine mais qui viennent d’autres pays », constatent Janice et Nathalie, présentes lors de l’évènement. Face à la multiplication de structures mono-culturelles dans lesquels les diasporas se retrouvent pour célébrer leurs traditions, elles ont souhaité créer une alternative. Leur objectif : imaginer des espaces ouverts où les cultures au pluriels puissent être exprimées à travers la cuisine, la diffusion de témoignages audios, des expositions, des ateliers etc.

Nathalie et Janice, les fondatrices de l’association NOMA. Photo de Loïs Hervouet.
Sur la page Instagram de NOMA, on peut y lire leur définition de la multiculturalité : « la cohabitation de plusieurs cultures au sein d’un même espace […] elle reflète la diversité des langues, des coutumes, des modes de vie, des valeurs apportés par des groupes différents. C’est une source d’enrichissement de la société ».
Écoute collective
C’est une vingtaine de personnes, familières ou non des questions de multiculturalité qui se sont rassemblées autour des tables des Impertinantes pour écouter ensemble les témoignages de Patricia, Mariette, Magdalena, Nathalie, Maeva, Rubi, et Audrey-Evelyne… des proches de NOMA enregistrés par les membres de l’association. Les sujets abordés étaient divers : le lien avec la France, leur pays d’origine, l’école, les enfants, les parents… mais toujours avec la thématique de multiculturalité comme fil conducteur.
Le choix de diffuser des témoignages oraux crée des podcasts au format « assez immersif », constate Janice. De plus, le fait de les partager en collectivité est une manière innovante de transmettre des histoires. « On peut piocher que ce qui nous intéresse et sur des thèmes un peu variés », souligne Emma.

Ecoute attentive aux Impertinantes. Photo de Loïs Hervouet.
« Je ne peux pas me définir à l’ombre de ma culture comme je ne peux pas me définir qu’à l’ombre de mes origines », peut-on entendre parmi les témoignages. Ce sont des histoires propres à chacun·es mais qui parle aux auditeur·ices. « J’ai trouvé ça assez touchant en fait, on sent l’émotion dans la salle à certains moments. On sent que parfois c’est un peu plus détendu, les gens rient tout d’un coup, on partage pas mal de choses », confie Alizée aux Impertinantes. « Entendre des gens qui ont vécu des choses similaires à moi c’est un peu rassurant de dire qu’on n’est pas tout seul face à des thèmes qui sont quand même assez flous ».
Écouter sans voir, sans débats
Janice ajoute un point important concernant la force de la diffusion de témoignages oraux : « c’est aussi intéressant parce que l’audio protège d’une certaine manière, tu ne vois pas à quoi ressemble la personne qui parle donc dans des questions autour de la multiculturalité ça protège ». En effet, les audios retranscrivent les émotions derrière les histoires que l’on a pu entendre, ce qui y ajoute une plus-value, sans qu’il n’y soit nécessaire de poser un visage sur la voix.

Des livres sur la multiculturalité étaient mis à disposition. Photo de Loïs Hervouet
Pour les organisatrices, ces témoignages vont « provoquer des choses à l’intérieur de soi, ça peut amener à des échanges et des envies de creuser », mais il n’est pas question ici de « créer un débat collectif […] car on ne débat pas sur la vie des gens », souligne Nathalie.
Pendant l’écoute, des papiers et des crayons sont mis à disposition pour que les auditeur·ices puissent griffonner des dessins ou des petits mots. S’iels le veulent ils peuvent laisser leurs productions dans une boîte à disposition qui seront redistribués aux personnes qui ont témoigné. Car un des objectifs de NOMA est aussi de donner une voix à cell·eux qui n’ont pas l’espace pour s’exprimer.
Depuis leur création, elles investissent des espaces nantais engagés pour y organiser des cantines à prix libre, des écoutes de podcasts et des ateliers pour engager la discussion. Après l’écoute collective de ce samedi, Nathalie a proposé un moment d’échange en proposant des tatouages au henné. C’est un atelier prétexte pour créer des moments d’échanges : « je vais te transmettre quelque chose de moi », se réjouit-elle.

« Je vais te transmettre quelque chose de moi ». Photo de Loïs Hervouet.
Les prochains rendez-vous :
- En partenariat avec JetFM, NOMA cherche des témoignages sur des acteur·ices du quartier de Bellevue pour parler de la dynamique de ce lieu.
- Des ateliers écritures et des tables rondes autour du colorisme dans les diasporas et de la multiculturalité en mixité choisie sont à prévoir dans les prochains mois.