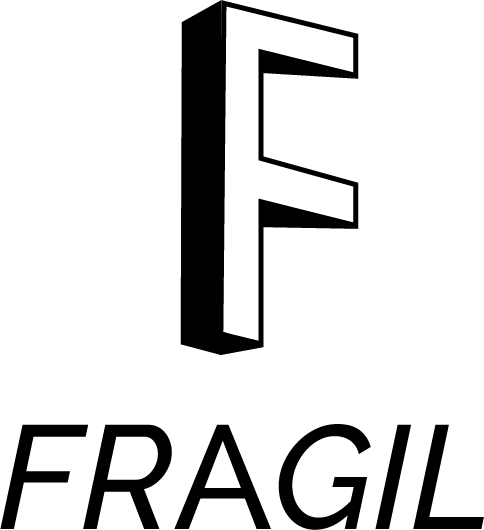Si le Projet de Loi de Finances 2026 était voté tel quel, le Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) passerait d’un budget annuel de 35 millions à 19 millions d’euros. Selon la Confédération Nationale des Radios Associatives et le Syndicat National des Radios Libres, cette baisse de 44% du FSER pourrait signifier la disparition de la moitié des radios associatives en France et la perte de 80% des emplois du secteur. L’équipe de Fragil est allée à la rencontre de 4 radios nantaises pour comprendre l’importance de ce fonds public dans leurs structures et leurs missions.
Une perte d’emplois assurée
La première répercussion d’une éventuelle baisse du budget du FSER serait la perte d’emplois salariés. Par exemple, pour Jet FM, le FSER équivaut à un peu plus d’un poste à temps complet, alors que pour euradio, Prun’ et SUN, c’est environ le quart de leur budget de fonctionnement.
La situation pour Jet FM est particulièrement tendue depuis la menace de sa fermeture en juin. Sans journaliste ni technicien·ne, la radio située au cœur du quartier Bellevue est passée de 7 à 3 salarié·es en seulement 1 an et demi. Même si « financièrement, ça va mieux » à la suite d’un appel aux dons et de la mobilisation des bénévoles, la coordonnatrice Valentine Chevalier espère plutôt pouvoir obtenir un autre temps plein d’ici la fin de l’année.
Derrière la perte d’emplois, ce sont toutes une série de services qui ne pourront plus être rendus. « Un emploi qui saute, c’est beaucoup de choses en moins faites pour nous : l’accompagnement de bénévoles qui viennent faire des émissions à l’antenne chaque jour ou les actions d’éducation aux médias qu’on fait partout sur le territoire » résume Romane Salahun, directrice d’antenne à la radio universitaire Prun’.

Situé au même étage que SUN et euradio, l’équipe de Prun’ (Teva, Mélanie, Clément, Romane, Yelena et Luka) mobilise plus de 250 bénévoles, dont 15% sont des étudiant·es. Crédits Valérie Babin – 30/10/2025.
La mission sociale des radios associatives
Le FSER a été créé en 1982 pour soutenir les radios associatives dans « leur mission de communication sociale de proximité auprès des territoires » (Ministère de la Culture). Or, les radios associatives sont unanimes, si ce financement venait à baisser de 44%, elles ne pourraient plus remplir cette mission : « si des médias comme les nôtres le faisons pas, personne ne le fera » martèle Eva Jarnot, directrice adjointe de SUN. Même son de cloche chez Jet FM : « Les radios associatives ne peuvent pas fonctionner sans un minimum de soutien de subventions publiques en fait. Le modèle ne tient pas ».
Concrètement, comment se traduit cette mission de proximité ? Du côté culturel, la coordonnatrice de Jet FM explique que les radios associatives « parlent, valorisent, observent et sont des interlocutrices de pleins d’initiatives locales qui passeraient potentiellement sous les radars des médias nationaux ou un peu plus gros ». Les radios associatives valorisent également la pluralité des voix présentées dans leurs programmations, notamment celles des jeunes qui sont actif·ves comme bénévoles au sein de leurs structures. « On est garant de montrer cette diversité de propositions qui existent sur les territoires » souligne la directrice adjointe de SUN.

Dans leurs locaux près du marché Talensac, une partie de l’équipe de SUN, qui célèbrera son 30e anniversaire en 2026, dont Eva Jarnot au premier plan à droite. Crédits Valérie Babin – 30/10/2025.
Un autre aspect de cette mission sociale passe par le partage de connaissances et les espaces d’expérimentation. Valentine de Jet FM explique avec passion : « Je trouve qu’il y a un autre truc qui est hyper fort dans les radios associatives, c’est la grande liberté qu’ont les bénévoles et la possibilité qu’ils ont d’avoir des retours, d’être formés. On peut arriver, essayer, proposer des choses, se planter cinq fois, recommencer six ».

Dans leur studio du quartier Bellevue, Valentine Chevalier, coordonnatrice, et XM Tram, responsable action culturelle et éducation aux médias de Jet FM ne cachent pas leur camaraderie. Crédits Valérie Babin – 30/10/2025
Une diversification des revenus limitée
Toutes les radios associatives rencontrées ont déjà réfléchi à des manières de diversifier leurs revenus. Elles offrent des prestations de service pour monter des podcasts ou encore des ateliers à l’Éducation aux médias et à l’information auprès de différents publics. De son côté, euradio a fermé des fréquences de diffusion et s’est penchée sur la recherche de mécènes depuis la perte de l’ensemble des subventions de la Région des Pays de la Loire en mai dernier. Malgré tout, Hélène Lévêque, directrice adjointe de cette radio centrée sur les actualités européennes, rappelle que le contexte général montre ses limites : « Finalement, les mécènes sont hyper sollicités ! Toutes les associations cherchent à développer ça pour diversifier leur financement. »

De gauche à droite, Elouan Prat, Manon Vieillet, Claire-Marie Lemasson, stagiaire et services civiques font des tests de son dans les locaux d’euradio avant l’entrevue avec Hélène Lévêque, la directrice adjointe. Crédits Valérie Babin – 30/10/2025
Valentin Beauvallet, directeur de la Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire, mentionne également que la lutte des radios associatives s’inscrit dans une lutte globale portée par le secteur associatif et les baisses de subventions de la région. Née d’une indignation face au sous-financement du secteur associatif, le mouvement « Ça ne tient plus » pointe des incohérences dans le système, que le directeur paraphrase ainsi : « À une certaine époque, on se disait ‘On a telle politique à mettre en place, on va mandater les associations pour le faire via des appels à projets et ça nous coûtera beaucoup moins cher’. Et puis l’étape d’après, c’est de dire ’Les associations, débrouillez-vous’. En fait, c’est toute la société qui est touchée si on arrête d’aider les associations. »
À titre d’exemple de cette circularité, l’Éducation aux médias et à l’information revient dans les discours des radios. Elles constatent que les demandeurs, eux-mêmes, n’ont plus les financements pour faire intervenir les employé·es des radios dans leurs milieux. Romane de Prun’ souligne que ces ateliers se font parfois auprès de jeunes demandeurs d’asile, de publics sous main de justice ou encore d’allophones. Auparavant, ces structures pouvaient avoir accès à des ateliers d’EMI grâce à d’autres subventions publiques comme le Pass Culture ou les crédits culture pour les établissements scolaires, « mais en fait, c’est tout cet écosystème-là qui prend des baisses ».
Au moment d’écrire ces lignes, un amendement de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation a été adopté de manière trans-partisane pour que le budget du FSER soit maintenu aux 38 millions d’euros demandés par les radios associatives[1]. Néanmoins, le processus d’adoption du budget n’étant pas terminé, les radios associatives demeurent dans un état de vigilance.
Malgré un réseau « très structuré qui donne une vraie force de frappe » lorsque vient le temps de se mobiliser, Valentine Chevalier de Jet FM rappelle que toutes les radios associatives ont des économies fragiles. Quatre d’entre elles sont d’ailleurs en recours collectif contre le conseil régional des Pays de la Loire pour un « non-respect de ses propres renseignements » (Ouest France).
[1] Les radios associatives demandent un retour à 35 millions avec l’ajout du « Bonus ruralité » qui fait monter l’enveloppe budgétaire totale à 38 millions.