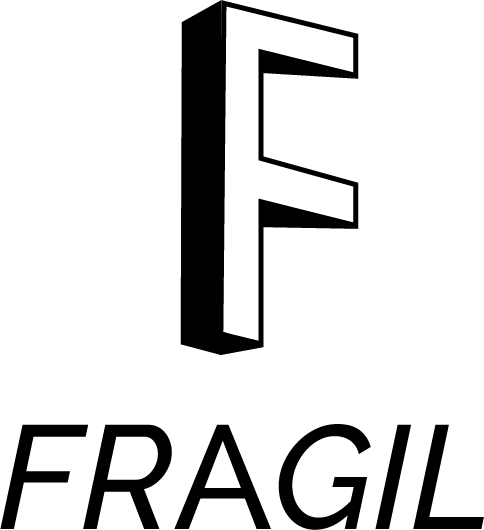A la tête de la Comédie Française depuis 2014, Eric Ruf poursuit dans ses programmations un fascinant travail de théâtre sur des films mythiques. Après « Les damnés » de Luchino Visconti (2016), « La règle du jeu » de Jean Renoir (2017), la troupe explore cette saison « Fanny et Alexandre » d’Ingmar Bergman Salle Richelieu et « Le voyage de G. Mastorna » d’après Federico Fellini au Vieux Colombier, dans une passionnante rencontre entre les arts. Cette démarche illustre aussi le parcours de Bergman, à la fois homme de cinéma et de théâtre. A côté de films marquants tels « Le Septième Sceau » (1956) ou « Les fraises sauvages » (1957), d’une adaptation très poétique de « La flûte enchantée » de Mozart au cinéma (1975), cet immense artiste a également monté un nombre impressionnant de pièces, de Shakespeare à Strindberg, de Molière à Brecht ou Garcia Lorca. Il figure désormais au répertoire de la Comédie Française.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2019/04/fanny_160_be.jpg » credit= »Brigitte Enguerand / Divergence » align= »center » lightbox= »on » caption= »Ce mouvement à rebours amène d’emblée une troublante confusion. » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
L’émerveillement de la scène
Tout ce début est envoûtant, orchestré par une énergie qui transporte.
Au début de la représentation, les lumières de la salle restent allumées et Oscar Ekdahl s’adresse au public pour le remercier d’avoir vu la pièce. Ce mouvement à rebours amène d’emblée une troublante confusion entre l’illusion et la réalité. Un tel procédé où l’acteur parle aux spectateurs était récurrent dans les mises en scène de Bergman. Ce directeur de théâtre, incarné par Denis Podalydès, nous conduit ensuite derrière un imposant rideau rouge, dans une sorte d’envers du décor, où les comédiens de la famille Ekdahl fêtent Noël sur scène, à l’issue de leur spectacle. Mais c’est à une autre fête que nous sommes conviés, celle du théâtre, où l’on reconnaît des visages familiers de la troupe de la Comédie Française. Tout ce début est envoûtant, orchestré par une énergie qui transporte. On y devine dans le sourire radieux d’Elsa Lepoivre le bonheur d’être sur le plateau, et cette ferveur est partagée par tous, dans chaque déplacement, dans chaque danse ou dans les chants. Chacun exprime à sa manière son émerveillement d’être là, à l’abri de la réalité ; les regards sont intenses, et l’émotion semble évidente, dans la complicité entre les acteurs. Ce qui est donné à voir est extrêmement fort, devant le mur du fond de la Salle Richelieu, avec pour accessoires des chaises et une table sur tréteaux. On partage ce bonheur, et on est même au bord des larmes ; on se sent aussi un peu voyeurs de quelque chose qui ne nous appartient pas. Julie Deliquet est parvenue à rendre palpable l’indicible qui enveloppe le jeu, qui est de l’ordre de l’intime, du dépassement de soi et du don total. Il y a une captivante mise en abyme, où l’on voit cette troupe de l’intérieur, en train de jouer. C’est superbe, et on se laisse prendre par cette plongée dans l’illusion.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2019/04/fanny_239_be.jpg » credit= »Brigitte Enguerand / Divergence » align= »center » lightbox= »on » caption= »Les regards sont intenses, et l’émotion semble évidente, dans la complicité entre les acteurs » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
L’hommage au théâtre se décline dans une scénographie où l’on joue avec tout…
L’hommage au théâtre se décline dans une scénographie où l’on joue avec tout, avec notamment des réminiscences d’autres spectacles. On reconnaît en particulier le lit de Juliette, et les carreaux des murs de sa chambre, dans « Roméo et Juliette » mis en scène en 2015 par Eric Ruf (qui collabore avec Julie Deliquet à cette scénographie), mais aussi les arbres que ce dernier avait conçus pour « Cyrano de Bergerac », dans la vision de Denis Podalydès (2006). Toute cette première partie enchaîne des moments de jeu. Fanny et Alexandre, les enfants d’Oscar et d’Emilie Ekdahl, entretiennent cette fascination familiale et s’aventurent dans des souterrains obscurs, pour inventer un spectacle d’ombres chinoises, dans un théâtre vide où ces jeux d’enfants paraissent clandestins. Dominique Blanc joue Helena Ekdahl, la mère, une ancienne comédienne qui participe aussi à cette fête du théâtre. Devant l’insistance des membres de sa famille, elle dit un monologue de « La maison de poupée » d’Ibsen, et, plus tard, se laisse aller à une tirade de « Phèdre », dont elle a été une immense interprète dans la mise en scène de Patrice Chéreau (2003). Dans la sombre lumière d’une servante (lumière de théâtre), Hélena se souvient des sublimes mots de Racine ; elle exprime également de manière très belle le travail du temps, le vieillissement et un certain découragement. Avant son entrée à la Comédie Française en 2016, Dominique Blanc s’était déjà emparée de figures de romans au théâtre. On garde un souvenir ému des « Liaisons dangereuses », d’après Laclos au TNB de Rennes (2015) et les spectateurs du Grand T à Nantes ont eu le bonheur de la voir dans « La douleur » d’après Marguerite Duras, dans la vision de Patrice Chéreau (2008).
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2019/04/fanny_259_be.jpg » credit= »Brigitte Enguerand / Divergence » align= »center » lightbox= »on » caption= »La troupe Ekdahl a le projet de monter « Hamlet » » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Cette mort de théâtre sème à nouveau la confusion entre l’illusion et la réalité.
Cette première partie s’affranchit de tout repère temporel. Nous sommes au théâtre, maintenant. La troupe Ekdahl a le projet de monter « Hamlet », et l’on assiste, sans transition avec la fête, aux premières répétitions de la pièce de Shakespeare. Oscar est le metteur en scène, et il joue le spectre. Autour du plateau, les autres comédiens, assis par terre ou sur des chaises, l’assistent et l’écoutent, mais dans un coin, Fanny et Alexandre jouent les gardes ; sous leurs armures, ils se moquent des indications grotesques et dérisoires de leur père. Soudain, le directeur du théâtre est pris d’un malaise, tout bascule et il meurt en pleine répétition, rattrapé par le réel. Cette mort de théâtre sème à nouveau la confusion entre l’illusion et la réalité. L’effet est brutal, on passe du rire aux larmes et les lumières s’allument pour l’entracte, durant lequel on entend les cris et les gémissements d’Emilie.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2019/04/fanny_271_be.jpg » credit= »Brigitte Enguerand / Divergence » align= »center » lightbox= »on » caption= »Elsa Lepoivre incarne avec une justesse poignante cette femme déchirée… » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Un théâtre de la cruauté
Elsa Lepoivre incarne avec une justesse poignante cette femme déchirée…
Au début de la seconde partie, c’est Emilie qui s’adresse au public, un an après la mort de son mari. Elle a pris sa succession à la tête du théâtre familial, mais elle veut changer de vie. Elsa Lepoivre incarne avec une justesse poignante cette femme déchirée qui, durant ce qui va suivre, changera successivement de masque, dans une même sincérité. Elle avoue aux spectateurs qu’elle a tiré le théâtre au dessus de sa tête, comme une couverture. Mais cette couverture est désormais encombrante, et elle aspire à une nouvelle naissance et une vraie passion, dans la réalité, laissant derrière elle ce petit monde pourtant rassurant. Dans la galerie des portraits savoureux qui peuplent son ancienne vie, on garde en mémoire les frères d’Oscar, merveilleusement dessinés par Hervé Pierre, truculent Gustav Adolf, et Laurent Stocker, Carl, professeur frustré qui rappelle l’univers de Tchekhov. Véronique Vella est saisissante en Lydia, l’épouse allemande de Carl, qui vit dans l’émerveillement pour celui qu’elle aime, un troublant magnétisme et une sorte d’amour inconditionnel, malgré ce qu’il lui fait subir. Il y aussi Mademoiselle Ester, la femme de chambre d’Elena, à laquelle Cécile Brune donne une présence intense, et Maj, la préceptrice de Fanny et Alexandre, incarnée de manière touchante et vraie par Julie Sicard. Mais Emilie rêve d’un ailleurs, dans un monde plus grand.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2019/04/fanny_304_be.jpg » credit= »Brigitte Enguerand / Divergence » align= »center » lightbox= »on » caption= »Mais Emilie rêve d’un ailleurs, dans un monde plus grand. » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Mais l’univers tant espéré révèle une autre dramaturgie, étouffée par des principes désincarnés…
Accompagnée de ses deux enfants, c’est dans l’austère demeure de l’évêque Edward Vergerus qu’Émilie va assouvir sa soif de passion. Mais l’univers tant espéré révèle une autre dramaturgie, étouffée par des principes désincarnés, dans un nouvel envers du décor. Thierry Hancisse apporte à la figure de l’évêque un relief particulièrement inquiétant, et une perturbante violence. Vergerus vit avec sa sœur, Henrietta, dont Anne Kessler donne une image impassible et sinistre, avec des lunettes noires qui la rendent encore plus rigide. Fanny et Alexandre ne sont pas heureux à l’intérieur de ces nouvelles règles. Le théâtre prend d’autres formes dans ce monde suffocant. Le jeune garçon voit apparaître des spectres, comme celui de son père à qui il réclame des comptes, et il songe à l’ancienne femme de l’évêque, dont la mort mystérieuse soulève des interrogations. C’est aussi le règne de la délation et Alexandre est dénoncé par une domestique, pour les rumeurs qu’il colporte. La réaction de Vergerus est monstrueuse, et le spectateur est à nouveau placé dans une position de voyeur malgré lui. Dans une scène particulièrement insoutenable, l’évêque exige du fils d’Emilie qu’il se mette nu, avant d’être battu, sur le lit de « Roméo et Juliette ». Ce qui restait des idéaux d’Emilie Ekdahl est ruiné. Au terme d’un mouvement de va-et-vient entre illusion et réalité, qui donne le vertige, Edward Vergerus, complètement endetté, meurt en pleine nuit, de manière irréelle : le discours d’un magicien démiurge, aux côtés d’Alexandre, fait de sa mort un nouveau moment de théâtre, tandis qu’un rideau tombe lentement.
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2019/04/fanny_324_be.jpg » credit= »Brigitte Enguerand / Divergence » align= »center » lightbox= »on » caption= »Ce qui restait des idéaux d’Emilie Ekdahl est ruiné. » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]
Ceux qui étaient partis sont de retour.
Fanny et Alexandre sont joués par Rebecca Marder et par Jean Chevalier. Ils épousent de manière impressionnante des situations contrastées, dans une palette de jeu d’une variété inouïe. Ils sont mémorables, et complètement investis dans ce théâtre total de chaque instant. Durant les scènes d’enfermement chez l’évêque, une porte reste ouverte sur le monde des Ekdahl. Un glissement s’opère d’un univers à l’autre ; Emilie, complètement anéantie, se rend au théâtre en véritable tragédienne pour exprimer sa détresse, tandis que les frères rappellent de sombres histoires d’argent chez Vergerus. Les scènes s’imbriquent de manière fascinante d’un lieu à l’autre, et l’espace suivant s’installe alors que les protagonistes de la scène qui s’achève sont toujours là, dans un bel effet cinématographique. Après la mort de l’évêque, la troupe est à nouveau réunie, et c’est Helena qui s’adresse, pour cette dernière fois, au public, « Notre petit monde s’est refermé sur nous ». Ceux qui étaient partis sont de retour. Elle annonce les spectacles de la prochaine saison dans leur théâtre. Ils joueront « Le songe » de Strindberg, une pièce qui confronte également l’illusion au réel, en un ultime jeu de miroir. La pièce s’achève sur ces mots, « L’auteur laisse libre cours à son imagination ».
[aesop_image imgwidth= »60% » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2019/04/Affiche-FANNY-ET-ALEXANDRE_40x60_typo_EXE-02.jpg » align= »center » lightbox= »on » captionposition= »center » revealfx= »off » overlay_revealfx= »off »]