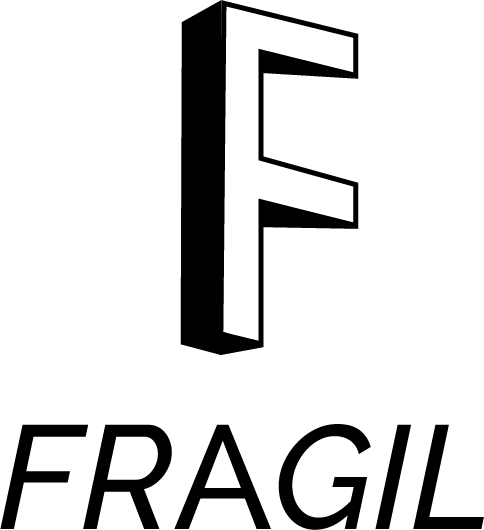Pendant les cinq derniers jours de novembre 2025, la 23e édition du festival Culture Bar-Bars transforme près d’une centaine de bars en salles de concert. Les équipes des lieux les plus actifs se confient sur leur investissement. Avec des parcours très différents dans la gestion, la programmation ou l’expérience du festival, la conviction de défendre la culture de proximité les unit.
Faire vibrer la ville
Si programmer plusieurs soirs de suite relève d’un défi logistique, cette intensité forge l’esprit du festival. À L’Ubik, au bout de la rue Joffre, Arnaud tient à enchaîner les soirées pour permettre à chacun·e de trouver un créneau pour sortir. Au Lutin de Travers à Bouffay, Warren apprécie cette effervescence, qui suscite « une grosse activité à la fin du mois de novembre ». Pour Mathieu et Asher, qui ont repris cet été le Café Landru, situé près de la place Royale, ce premier Bar-Bars aide aussi à prendre ses marques. Au programme dans l’ensemble des cafés-cultures, un éclectisme prononcé : fanfare, DJ sets, techno, électro, punk, conte, etc. Beaucoup restent dans la continuité de leur ligne habituelle, en profitant de Bar-Bars pour oser davantage.

De gauche à droite : Arnaud, programmateur à L’Ubik ; Warren, tenancier du Lutin de Travers ; Mathieu et Asher, co-gérants du Café Landru, novembre 2025 © Fragil
Pour le public, cette densité crée du mouvement. Arnaud constate davantage de déambulations d’un lieu à l’autre. Warren accueille « les habitués de 50-60 ans qui faisaient déjà les premières éditions » comme « des jeunes de la vingtaine qui vont découvrir le festival pour la première fois ». Loïc, co-gérant de L’Enchantier dans le quartier Dalby, observe que « les personnes entrent dix minutes avant un concert et repartent à la fin vers un autre ». Yann, serveur au Chat Noir en plein cœur de Commerce, s’en amuse : « ça rend les gens de très bonne humeur ». Impatient de ce long week-end de fête, il s’exclame : « c’est le week-end où les bars revivent ! »
Un engagement collectif au-delà d’un simple week-end de fête
Pour beaucoup, participer relève de l’évidence. Loïc explique que l’adhésion « s’est imposée naturellement ». Il apprécie « la philosophie de partage et de mettre en commun » du collectif Culture Bar-Bars. Warren le décrit comme un réseau capable « de faire le lien avec les pouvoirs publics » pour défendre les cafés-cultures, presque « comme un syndicat ».
Les gérant·es voient en Culture Bar-Bars un appui pour affronter les problématiques récurrentes : disparition des aides publiques, fréquentation en berne, conflits avec le voisinage liés aux nuisances sonores… À leurs yeux, le collectif développe la solidarité entre indépendant·es. Au BB’O sur l’île de Nantes, Manu et Clé attendent « plus de respect pour ces métiers ».

De gauche à droite : Loïc et Benjamin, co-gérants de L’Enchantier ; Manu et Clé, co-gérants du BB’O ; Becky et Yann, serveurs du Chat Noir Bistrot des Arts, novembre 2025 © Fragil
Malgré les tensions, tou·tes gardent en tête l’importance du bar comme lieu de sociabilité. Manu relate : « un directeur de banque peut discuter avec un gars de la rue. » Becky, serveuse au Chat Noir, parle d’un bistrot des arts qui « accepte toutes les cultures », où se croisent « étudiants, personnes d’origine somalienne, queers et gens de passage ». Loïc voit son comptoir en zinc comme un « catalyseur », un endroit où les rencontres brèves ont toute leur importance.
Le bar comme safe place est aussi une valeur socle des adhérents au réseau. Yann a participé à l’un des ateliers proposés par le collectif sur « les violences sexistes et sexuelles côté clients et côté staff » lors d’une rencontre nationale. Loïc tire son « chapeau à Bar-Bars pour le travail d’insistance sur la prévention », satisfait des kits de communication distribués chaque année.
Soutenir la scène locale dans un contexte difficile
« Soutenir la scène locale, c’est pas seulement offrir un espace aux groupes pour jouer, c’est aussi leur donner des cachets. Les bars sont souvent les premières scènes des artistes » déclare Warren. Derrière cet état d’esprit partagé, le contexte se dégrade. Les aides et les dispositifs comme le GIP Café-Culture et le Fonpeps se raréfient.
S’ajoute aussi la baisse de fréquentation. Warren parle d’un recul « entre 20 et 40 % selon les lieux » depuis le Covid. Manu évoque une chute « jamais vue en vingt ans ». Mathieu et Asher constatent que les client·es « se serrent la ceinture ». Dans ces conditions, programmer des concerts relève parfois de la prise de risque, mais personne ne parle d’abandonner.

Les professionnel·les du secteur réunis à l’inauguration de la 23e édition de Culture Bar-Bars au bar Boucan, le 26 novembre 2025 © Amélie Fortin
Pour continuer à faire jouer des artistes, les responsables de ces lieux improvisent des solutions : prix libre, co-plateaux, mutualisation de dates, partenariats avec des associations, réseaux de tourneurs, bricolages logistiques. Les cafés-cultures restent déterminés à défendre ces lieux vivants. Warren garde espoir : « les gens reviendront ».
Au coup d’envoi du festival, Jeanne Caillaudeau, présidente du collectif Bar-Bars, fait preuve de la même énergie dans son discours d’inauguration : « cette année, nous avons choisi un mot pour notre festival : la joie. Parce que nous en avons besoin. Parce que les temps sont lourds. Parce qu’on a tou·tes envie d’un endroit où respirer, se retrouver, chanter, danser en toute liberté ».
Pour aller plus loin
- La programmation complète de Culture Bar-Bars 2025
- 22e édition de Culture Bar-Bars : des festivités plus diversifiées à Nantes
- FESTIVAL CULTURE BAR-BARS 2023 : 110 bars et clubs nantais en fête !
Article conçu en collaboration avec Marline Hervé, Louise Bret, Josué Texier et Armel Bihan.