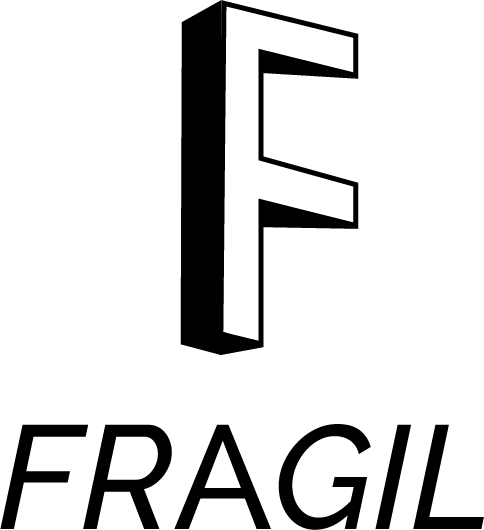Fragil : Vous avez monté une dizaine de pièces de Copi tout au long de votre carrière et vous avez notamment créé en France Une visite inopportune lors de votre première saison à la tête du Théâtre National de la Colline à Paris. Comment présenteriez-vous cet auteur?
Jorge Lavelli : Copi a été un grand ami, jusqu’à sa mort en 1987. Lorsque je l’ai rencontré en 1964 à Paris, il était une star. Il travaillait au Nouvel Observateur et connaissait beaucoup de succès avec ses dessins, qu’il vendait déjà sur le Pont des Arts à son arrivée dans la capitale. Ne s’intéressant pas à l’actualité, son inspiration était plus personnelle. Il était le fils d’un homme politique argentin, directeur d’un journal important (Tribuna Popular, ndlr) qui tirait six éditions par jour ! Buenos Aires est une ville complètement folle, où les gens lisent tout. Copi était très attaché à ce père qu’il a suivi lorsque ce dernier a été obligé de partir en Uruguay pour raisons politiques. Ils sont ensuite tous deux restés longtemps à Paris. C’était aussi un magnifique romancier, mais ses quatre romans sont moins connus que ses pièces de théâtre, dans lesquelles il a parfois joué et qui ont toutes été montées.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2016/10/Lavelli_5338.jpg » credit= »Laurent Guizard » alt= »L’ombre de Venceslao, création mondiale à l’Opéra de Rennes. » align= »center » lightbox= »on » caption= »L’ombre de Venceslao, création mondiale à l’Opéra de Rennes. » captionposition= »center »]
Fragil : Quelles ont justement été ses premières pièces que vous avez créées ?
Jorge Lavelli : Mon premier souvenir est celui d’un spectacle complètement surréaliste. Copi m’avait fait lire, lorsque nous nous sommes rencontrés, un dialogue plein d’humour, Sainte Geneviève dans sa baignoire, en me demandant si, pour moi, c’était du théâtre. Il y avait à l’époque à Saint-Germain-des-Prés une grande salle dans laquelle on avait fait plusieurs pièces expérimentales. J’ai sollicité Arrabal pour qu’il m’écrive un dialogue afin de compléter le texte de Copi. C’était une improvisation contrôlée, sur patins à roulettes, avec un mime qui venait du Japon, une danseuse et un percussionniste génial, Daniel Humair. Une photographe donnait la réplique à Copi qui lisait son texte, nu dans une baignoire. Le point final de l’histoire était l’explosion d’un ballon qui figurait un globe terrestre. Cette fin était marquée par un autre crescendo : le musicien, qui était vraiment fantastique, cassait ses instruments dans un geste d’une violence extraordinaire. Cette performance, pour laquelle nous avions aussi la complicité de peintres, reposait sur la spontanéité et l’éphémère. Elle a connu un grand succès. C’était la pièce de Copi, mais j’avais établi les règles du jeu. J’ai ensuite monté La journée d’une rêveuse en 1967 au Théâtre de Lutèce. C’est une œuvre sur l’attente, la frustration et le temps qui passe, avec un côté tchékhovien. Après le soulèvement de mai 68, il y a eu un changement dans l’écriture de Copi, qui est devenue plus économe, plus beckettienne dans la simplicité du langage, même si les deux auteurs n’avaient rien à voir.
[aesop_quote type= »pull » background= »#282828″ text= »#ffffff » align= »left » size= »1″ quote= »C’était une improvisation contrôlée, sur patins à roulettes, avec un mime qui venait du Japon, une danseuse et un percussionniste génial » cite= »Jorge Lavelli » parallax= »on » direction= »left »]
Ce qui peut arriver après la mort
Fragil : Que raconte L’ombre de Venceslao ?
Jorge Lavelli : Il y a un thème récurrent chez Copi, qui était déjà présent dans Les quatre jumelles, que j’ai mis en scène dans les sous-sols du Palace, lors du Festival d’Automne de 1971 : il s’agit de ce qui peut arriver après la mort. L’ombre de Venceslao revient sur Terre à la fin pour remercier sa femme pour tout ce qu’ils ont vécu ensemble. Ce texte a été écrit en 1977 en espagnol, dans la langue campagnarde d’une famille d’un petit village argentin, assez intraduisible en français. Les protagonistes luttent contre une nature incontrôlable, à cause de la pluie, du vent et de la boue. C’est une histoire de départs et d’errances. Une partie de la pièce est restée dans le livret, notamment la relation incestueuse entre le fils et la fille de Venceslao, Rogelio et China, dont l’enfant meurt au début, dans des circonstances mystérieuses. Ils s’installent dans le Nord, cherchant un endroit calme et tranquille. Elle rêve d’aller à Buenos Aires pour voir sur scène Libertad Lamarque, une actrice très célèbre qui s’est mise à chanter du tango, et dont elle est folle, une sorte d’Edith Piaf argentine. Dans la première moitié du 20ème siècle, des gens sont venus par milliers en Argentine dans un espoir de liberté et d’indépendance. Le voyage s’organise ici autour de la figure du patriarche Venceslao, qui est aussi suivie par un singe, et par un perroquet qui parle beaucoup. Ils partent tous dans une charrette, essentielle à l’action. La fin est extraordinaire : Venceslao rêve de sa propre mort et confesse ses origines au perroquet. Il se pend et on le voit revenir pour saluer celle qui l’a accompagné durant toutes ces années. C’est très onirique, et d’une profondeur dramaturgique incroyable. Beaucoup de choses échappent au naturalisme chez Copi. J’ai monté cette pièce en 1999 au Théâtre de La Tempête, et l’ai reprise en 2001 au Théâtre du Rond-Point. Certains disaient à l’époque que L’ombre de Venceslao aurait pu devenir un opéra, mais je pensais plutôt à la Journée d’une rêveuse, une histoire mélancolique et plus intime. Il y a, c’est vrai, dans toute son écriture une manière de donner de la force aux mots par une organisation musicale du texte, comme chez Witold Gombrowicz.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2016/10/Matalon-et-Lavelli-gimp.jpg » credit= »Laurent Guizard » alt= »Martin Matalon et Jorge Lavelli lors d’une répétition de L’ombre de Venceslao. » align= »center » lightbox= »on » caption= »Martin Matalon et Jorge Lavelli lors d’une répétition de L’ombre de Venceslao. » captionposition= »center »]
Fragil : Comment avez-vous construit le livret de opéra, une création mondiale, à partir de la pièce de Copi ?
Jorge Lavelli : Je suis parti de la traduction en français pour mon spectacle de 1999. J’ai réduit l’ouvrage mais je raconte la même histoire, de manière plus synthétique. J’ai toutefois gardé les très nombreuses références musicales, indispensables pour le spectateur.
Fragil : De quelle manière définiriez-vous la partition de Martin Matalon ?
Jorge Lavelli : C’est son premier opéra. L’ouvrage suit l’histoire racontée par Copi, dans une grande liberté. La partition est atonale et son écriture très variée. Matalon a fait un travail complexe sur le plan musical, mais qui accorde une grande attention aux interprètes. Il assiste aux répétitions et il modifie parfois des choses.
[aesop_quote type= »pull » background= »#282828″ text= »#ffffff » align= »left » size= »1″ quote= »« L’ombre de Venceslao » est une histoire de départs et d’errances » cite= »Jorge Lavelli » parallax= »on » direction= »left »]
Fragil : Quels sont les grands axes de votre mise en scène ?
Jorge Lavelli : Pour l’instant, j’en suis au deuxième acte (l’entretien a été effectué le 17 septembre 2016, ndlr). Deux grands rideaux modifient les espaces de manière très libre, sans aucun naturalisme. L’expression est vraie, mais elle est marquée par l’artificialité, avec des moments de théâtre dans le théâtre. Le dispositif scénique est dépouillé, des éléments inattendus reflétant un monde plus lyrique et plus fou. L’essentiel est d’amener de l’émotion. Nous travaillons avec une équipe de jeunes chanteurs, dans des conditions plutôt exceptionnelles puisque nous avons six semaines de répétitions, ce qui est assez rare à l’opéra. Cette durée confortable permet au compositeur, au metteur en scène et au chef d’orchestre de réfléchir pour mieux jouer et être au plus juste. Cette expérience est passionnante.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2016/10/Laveli_5751.jpg » credit= »Laurent Guizard » alt= »L’ombre de Venceslao, création mondiale à l’Opéra de Rennes. » align= »center » lightbox= »on » caption= »L’ombre de Venceslao, création mondiale à l’Opéra de Rennes. » captionposition= »center »]
Fragil : Parmi vos nombreuses mises en scènes d’opéras, vous avez offert un Faust de Gounod devenu mythique, créé en 1975 à l’Opéra de Paris, où il a été repris régulièrement jusqu’en 2003. Quelles traces ce spectacle vous a-t-il laissées ?
Jorge Lavelli : Il a connu au départ un véritable scandale, avant de rencontrer ensuite un grand succès. Les premiers spectateurs se sont certainement sentis atteints dans leurs souvenirs d’enfance, et dans leurs représentations personnelles. La scène de l’église, avec ses 24 Méphisto, a soulevé beaucoup de questions. J’y vois ce qui se passe dans la tête de Marguerite, qui entre pour prier. A l’époque, un numéro spécial de l’Avant-Sène Opéra était paru pour expliquer chaque scène ! Nous avions construit une grande architecture qui permettait de donner un cadre à chaque tableau. Durant les 28 années de reprises, la mise en scène s’est montrée ouverte aux nombreux artistes qui l’ont nourrie. C’est pour moi un souvenir aussi fort qu’une création.
Fragil : La musique a toujours occupé une place très importante dans vos spectacles et vous avez notamment collaboré avec le compositeur Astor Piazzolla pour un Songe d’une nuit d’été de Shakespeare à la Comédie-Française, dans lequel l’inoubliable Richard Fontana jouait Puck. Quel souvenir en gardez-vous ?
Jorge Lavelli : C’est comme ces films que j’allais voir, quand j’étais petit, au cinéma à Buenos Aires. J’avais l’impression de passer de l’autre côté d’un miroir et d’entrer dans un univers magique. Cette pièce de Shakespeare a été écrite dans une période de paix, et l’amour en est le centre. Je voulais retrouver cette magie de mes souvenirs de cinéma. J’ai demandé à Piazzolla des musiques de tango, mais Shakespeare l’impressionnait. Il avait peur de cet auteur qui pourtant n’a rien de conventionnel. Je me souviens d’un numéro dansé par Richard Fontana, une scène de tango dans les règles, sans aucune dissimulation : c’était un retour aux sources.
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2016/10/Lavelli_5676.jpg » credit= »Laurent Guizard » alt= »L’ombre de Venceslao, création mondiale à l’Opéra de Rennes. » align= »center » lightbox= »on » caption= »L’ombre de Venceslao, création mondiale à l’Opéra de Rennes. » captionposition= »center »]
Les défis de la Colline
Fragil : Vous avez dirigé le Théâtre National de la Colline de 1987 à 1996. Quelle a été votre plus grande fierté au sein de cette fonction ?
Jorge Lavelli : Je me suis imposé de ne proposer, dans ce théâtre du XXème arrondissement, que des pièces du 20ème siècle, en me donnant du mal pour construire un répertoire et convaincre des gens qui parfois n’en voulaient pas. J’ai même eu des difficultés pour trouver un acteur pour le personnage central d’une Visite inopportune de Copi, la première pièce créée dans la petite salle en 1988. C’est pourtant un rôle formidable. Ces représentations sont pour moi historiques. Les spectateurs sortaient en pleurant. Copi était mort du sida fin 1987 et il savait que j’allais représenter ce texte, qu’il a écrit sur sa mort. Le protagoniste célèbre à l’hôpital la première année de sa maladie, et l’ambiguïté de sa mort, au théâtre, est poussée jusqu’au bout.
[aesop_quote type= »block » background= »#282828″ text= »#ffffff » align= »left » size= »1″ quote= »Ces représentations d’« Une visite inopportune » sont pour moi historiques. Les spectateurs sortaient en pleurant » cite= »Jorge Lavelli » parallax= »on » direction= »left »]
Fragil : Vous y avez notamment mis en scène, en 1991, la création en France de Heldenplatz de Thomas Bernhard, avec l’immense Annie Girardot. Que représente pour vous ce spectacle ?
Jorge Lavelli : J’avais déjà mis en scène Annie Girardot dans un monologue de Roberto Athayde au Théâtre Montparnasse, Madame Marguerite. C’était très difficile de travailler avec elle car elle était très sollicitée. Elle apportait beaucoup d’invention à ses rôles, et était tellement aimée du public ! Les gens l’applaudissaient dès son entrée en scène, ce qui altérait l’agressivité du personnage. Elle avait un magnétisme incroyable. Lorsque je l’ai retrouvée pour Heldenplatz, elle avait perdu une partie de sa mémoire. Les longs monologues de ce texte lui étaient difficiles à apprendre, et elle m’embrassait quand je faisais une coupure. C’est une pièce terrible dans laquelle Thomas Bernhard attaque les Viennois en dénonçant la honte. C’est sur cette Heldenplatz qu’Hitler a proclamé l’Anschluss en 1938. L’auteur voulait que cette œuvre ne soit jouée qu’au Burgtheater de Vienne, pour que la charge d’origine reste intacte. Son frère, détenteur des droits, m’a toutefois permis, in extremis, de la créer en France.
[aesop_quote type= »block » background= »#282828″ text= »#ffffff » align= »left » size= »1″ quote= »Annie Girardot avait un magnétisme incroyable » cite= »Jorge Lavelli » parallax= »on » direction= »left »]
Fragil : Durant cette même année 1991, vous avez offert une nuit de théâtre mémorable dans la cour d’honneur du Palais des Papes, au Festival d’Avignon, avec les Comédies Barbares de Valle Inclan. Comment traverse-t-on un tel marathon ?
Jorge Lavelli : J’avais travaillé sur cet auteur espagnol en mettant en scène Maria Casarès dans Divines Paroles à Buenos Aires quand elle était jeune. Maria était galicienne, je lui avais demandé de traduire ces Comédies Barbares, mais ça ne s’est pas fait. J’ai eu l’idée folle, beaucoup plus tard, de monter toute la trilogie, mais j’attendais d’avoir un théâtre pour le faire. Valle Inclan est un auteur génial, qui se permettait des choses extraordinaires dans le choix des mots. Les personnages sont inventés mais l’histoire sur le pouvoir est universelle. Certains considéraient ses pièces comme des romans dialogués, mais elles sont d’une beauté sublime, et c’est pour moi du vrai théâtre. Il installe le metteur en scène et les interprètes dans un contexte singulier. La trilogie durait huit heures à Avignon, et six heures réparties sur deux jours à la Colline. Nous avons fait un travail de création inouï et nous répétions à l’emplacement de l’actuel Stade de France, dans un local du Gaz de France, où nous avons fait des filages entiers de l’ouvrage !
[aesop_image imgwidth= »1024px » img= »https://www.fragil.org/wp-content/uploads/2016/10/Photo-décors-en-construction-Galerie-des-voleurs-DR.jpeg » credit= »DR » alt= »Construction des décors pour L’ombre de Venceslao avec la peinture Ladrones de Buenos AIres d’Alberto Bali. » align= »center » lightbox= »on » caption= »Construction des décors pour L’ombre de Venceslao avec la peinture Ladrones de Buenos AIres d’Alberto Bali. » captionposition= »center »]
Fragil : Par quels autres spectacles avez-vous été particulièrement ému durant votre itinéraire artistique ?
Jorge Lavelli : J’ai eu la chance de révéler au public espagnol Doña Rosita, la pièce de Federico García Lorca qu’il répétait lorsqu’il a été tué. Craignant qu’il ne lui arrive quelque chose, il en avait donné le manuscrit à un ami, qui l’a déposé dans une banque de Londres d’où il a été exhumé trente ans plus tard. Pour l’inauguration du Théâtre National de la Colline, j’ai retrouvé García Lorca avec Le public, où il fait l’aveu de son homosexualité et de ses principes politiques. C’était une création française. Ce sont des souvenirs extraordinaires de ma vie !