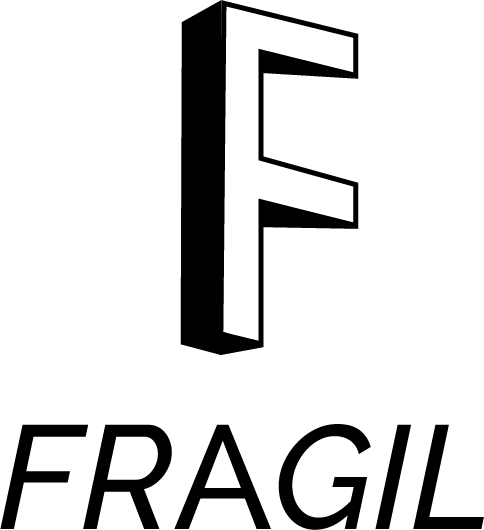« On doit trouver des solutions parce qu’on n’a pas le choix. » constate la plasticienne Sepideh Fouladgar, adhérente au SNAP CGT. Ce 22 novembre 2025, aux ateliers Dulcie September à Nantes, artistes et citoyen·nes débattent sans relâche. Dans le froid de novembre, les discussions s’enchaînent et s’enflamment. Entre constats alarmants, fatigue partagée et résistance bien présente, la mobilisation Future·s Culture·s révèle un secteur fragilisé mais déterminé à chercher des solutions ensemble.
Des dégâts encore impossibles à mesurer
David Rolland, chorégraphe et co-délégué national du Synavi déclare au nom des organisateur·rices : « on se sent investi de la mission de réagir contre cette politique qui n’est pas budgétaire mais idéologique ». Si les situations varient selon les métiers, l’inquiétude face aux coupes traverse toute l’assemblée. Une participante dénonce « beaucoup d’invisibilité dans tout ça et eux [NDLR : les pouvoirs publics] vont argumenter en disant “vous voyez, ça va”» faute d’un état des lieux précis.

David Rolland rappelle que tout le monde peut s’exprimer dans chacun des groupes de réflexion, le 22 novembre 2025. © Amélie Fortin
Ely, syndiqué au FNSAC-CGT, redoute « la disparition progressive des structures les plus fragiles ». Le technicien du son apprécie que cette mobilisation permette enfin « d’imaginer un futur désirable ». Nicolas Chenuet, trompettiste et syndiqué à la CGT, pointe le danger de la perte progressive des compétences artistiques et techniques. « S’il n’y a plus de financement, les gens vont se détourner de leur pratique et on va perdre un savoir-faire de très grande qualité », explique-t-il. Pour lui, affaiblir la culture revient à affaiblir l’économie. Il s’agace aussi que « la rentabilité serve trop souvent d’argument politique », un critère qui, selon lui, détériore le secteur.

De gauche à droite : Ely, Sepideh Fouladgar, Aurèle Salmon et Nicolas Chenuet, le 22 novembre 2025. © Amélie Fortin
Du côté des artistes-auteur·rices, Sepideh décrit un statut incomplet et une précarité extrême : pas de chômage, pas d’accident du travail, pas d’arrêt maladie et de faibles revenus. Elle rappelle cette statistique établie par le Parti communiste français : « 50 % des artistes-auteur·rices gagnent moins 8000€ par an ».
Culture dégradée, quotidien impacté
Au cours de la journée, les intervenant·es soulignent la porosité de la frontière entre artistes et spectateur·rices. Nicolas insiste : « on ne devrait pas envisager l’art avec une fracture entre les producteurs et les consommateurs, on fait tous partie du même système ». Pour lui, chacun·e est un jour amené·e à être dans « une démarche d’apprentissage, une démarche autodidacte, une démarche de création spontanée, informelle ». Sepideh appuie : « je ne connais personne qui n’écoute pas de musique, ne lit pas, ne va jamais au ciné ». Elle imagine Nantes sans artistes, « nettement moins attractive ». Au-delà de l’économie, leur disparition entraînerait « un appauvrissement intellectuel ». Elle résume : « la culture, c’est ce qui fait notre humanité ».

Une soixantaine de personnes, en majorité professionnelles du secteur, ont participé aux ateliers Future·s Culture·s, le 22 novembre 2025. © Amélie Fortin
Pour beaucoup, le problème dépasse le secteur culturel et ébrèche la démocratie. Maxime Séchaud-Do-Dang, secrétaire général adjoint de la CGT Spectacle rappelle que défendre la culture, c’est aussi protéger un espace démocratique fragilisé par l’extrême droite et les politiques de privatisation. Pour le metteur en scène et comédien, les mobilisations doivent s’inscrire dans un rapport de force plus large et engage à « faire front face à l’offensive, faut rien lâcher à court et à long terme ».
Imaginer la culture comme un service public
Les ateliers invitent à concevoir collectivement une sécurité sociale de la culture et une continuité des revenus pour les artistes-auteur·rices. Très vite, l’idée revient de penser la culture comme un véritable service public, au même titre que la santé ou l’éducation.

De petits groupes de participant·es partagent leurs idées et leurs expériences, le 22 novembre 2025. © Amélie Fortin
L’ambiance est studieuse malgré la fatigue qui se lit sur les visages. Personne ne se coupe la parole, chacun·e écoute et donne son point de vue. Loin des discours abstraits, les participant·es avancent des pistes concrètes de caisse commune, de gouvernance démocratique mêlant professionnel·les et citoyen·nes tiré·es au sort et d’accès universel ou modulé aux pratiques culturelles.
Pour structurer ces réflexions, plusieurs outils sont déployés comme un fanzine, un vidéomaton et une boîte à idées. Ils visent surtout à documenter un travail de longue haleine. Cette approche lucide ne prétend pas « tout résoudre en un jour », précise Victor Tetaz, en charge du fanzine.

Le fanzine est rédigé en direct par Victor qui synthétise les constats et les premières pistes de solutions, le 22 novembre 2025. © Amélie Fortin
Un mouvement qui refuse de s’éteindre
En fin d’après-midi, les chaises sont repliées pour laisser place au dancefloor prévu pour clôturer la journée. Le collectif prépare déjà un second rendez-vous au printemps, ainsi que des actions autour de l’anniversaire des coupes en décembre ou du prochain BISE festival de Nantes. La lassitude est là, mais personne ne parle d’abandon.
Aurèle Salmon, l’une des organisatrices, résume l’état d’esprit du jour : « je n’ai jamais autant sauvé ma peau qu’en sauvant celles des autres ». Si l’avenir de la culture inquiète, c’est parce qu’il concerne tout le monde. Et s’il mobilise encore, c’est parce qu’ici, personne n’a renoncé à « fabriquer un peu de réconfort » observe la comédienne et chanteuse.
Pour aller plus loin :