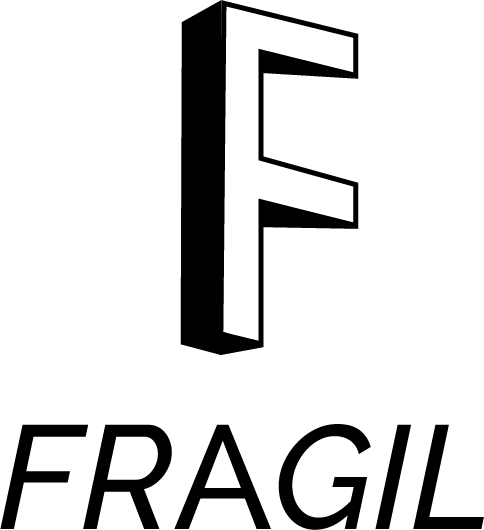«La première victime d’une guerre est toujours la vérité» disait Rudyard Kipling. La guerre en Ukraine n’échappe pas à la règle. Il suffit d’observer comment elle est relatée par les médias selon qu’ils sont russes, ukrainiens, américains ou français.
Patrick Chauvel, photographe de renom qui a couvert une trentaine de conflits l’a très bien exprimé lors de ces 10 ème Géopolitiques au Lieu Unique.
«L’objectivité n’existe pas. C’est une légende. Lorsque je couvre un conflit, je le regarde avec mes yeux, ma sensibilité, mon vécu, mon éducation, ma culture. Un russe va photographier les chars russes qui entrent en libérateur avec leurs drapeaux, un ukrainien aura tendance à glorifier les actes héroïques des ukrainiens. Moi je cherche simplement à comprendre ce qui se passe, à décrire une situation».
Sur le terrain, peu de recul
Gérard Grizbec, grand reporter à France 2 , a lui, insisté sur le manque de recul des hommes de terrain.
«A Paris, ma rédaction en chef a sûrement une vision plus large que moi sur le théâtre des opérations car elle reçoit des dépêches des agences de presse. Moi, je ne peux raconter que ce que je vois, c’est-à-dire mon nombril. C’est ce que j’appelle l’effet loupe».
En fait, il faudrait arriver à prendre de la distance et à se déplacer librement pour approcher la vérité. Mais en temps de guerre, les journalistes ne circulent que sous le contrôle des militaires. Ils sont «embeded», c’est-à-dire pris en charge par les autorités et s’ils veulent s’en échapper, c’est à leur risques et péril et sous leur responsabilité. Il arrive qu’ils soient pris en otage, torturé, décapité.
La liberté de circuler
Lorsqu’elle a couvert le conflit de l’ex-Yougoslavie pour le journal Le Monde, Florence Hartman a eu la chance de pouvoir passer d’un front à l’autre sans se faire remarquer.
«Je travaillais avec mon stylo. Mon visage n’était pas connu. Je pouvais donc me fondre dans la population sans être pris pour une espionne. Et comme je parlais le serbe et le croate, je n’avais pas d’interprète sur le dos. Généralement, ce sont des policiers qui sont là pour vous surveiller».
C’était sans doute une autre époque. Les téléphones portables et les réseaux sociaux n’existaient pas. Aujourd’hui, avec les chaînes d’information continue, les gens sont informés en temps réel et l’on accorde davantage d’importance à l’émotion qu’au raisonnement.
«La nouveauté de cette guerre en Ukraine, ce sont les visages des civils que l’on a montré» constate Isabelle Veyrat-Masson, directrice de recherche au CNRS. «80% des images montrées à la télévision représentaient des femmes et des grands-mères vivant dans la peur et sous les bombardements. Et comme nous nous sentons proches des ukrainiens, qu’ils aspirent à la même liberté, que leurs enfants chantent les mêmes chansons que les nôtres, nous nous identifions à eux et nous ressentons les mêmes émotions qu’eux».
C’est sans doute ce qui explique la décision de fermer en France Russia Today et Sputnik, deux médias russes qui servent à relayer la propagande russe, autrement dit à faire passer les européens et l’OTAN pour des ennemis de la Russie, les ukrainiens pour de vilains nazis soutenus par les occidentaux et les russes pour des victimes de ces agressions.

Une photo de Patrick Chauvel
L’information comme arme de guerre
D’ailleurs pour Florence Hartman, ces deux porte-paroles de la voix de Moscou n’ont aucune légitimité journalistique.
«Ce ne sont pas des médias car ils propagent des fake news en permanence. Dernièrement, ils ont accusé la CIA d’avoir organisé les massacres de Boutcha. Selon eux, ce serait un complot des américains pour discréditer la vaillante armée russe. Pour moi, Russia Today et Sputnik sont des armes de guerre».
Censure, manipulation, désinformation, répression. En temps de guerre, la transparence de l’information est une denrée rare. Chaque camp cherche à déstabiliser son adversaire, à masquer ses pertes, à taire ses défaites ou à dénoncer des crimes de guerre. Mais comme le dit avec honnêteté Gérard Grizbec : «Il n’y a pas d’un côté les bons et de l’autre les méchants. La réalité est toujours plus complexe que le récit qu’on en fait ».
Des photos pour écrire l’histoire
Pour Patrick Chauvel, il est facile de faire dire n’importe quoi à une image si on la sort de son contexte et de citer cet exemple.
«J’avais fait une photo d’une femme avec un bébé dans ses bras face à un blindé américain et un soldat qui la regarde. La légende de l’époque disait : elle supplie les soldats américains de ne pas l’exécuter. En fait le soldat américain venait de lui donner sa boîte de ration et elle le remerciait».
Mettre un nom sur les visages que l’on photographie, faire des recherches pour connaître son identité, sa famille, sa vie. Autant de bonnes pratiques qui empêchent toute manipulation.
Bien documentées, ces photos prises sur le vif peuvent d’ailleurs servir de preuve pour des procès futurs contre les criminels de guerre ce qui fait dire à Patrick Chauvel : «Je travaille pour suivre l’actualité mais aussi pour construire la mémoire collective, l’histoire avec un grand H».